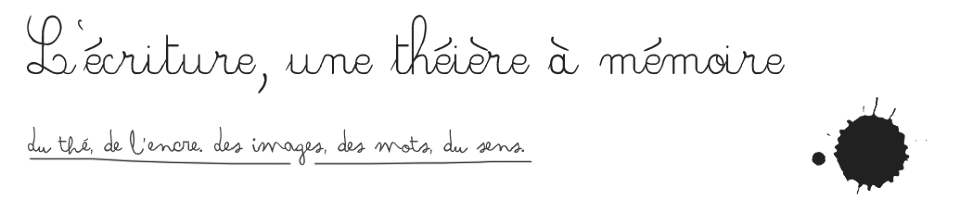Le silence qui nous absorbe, sitôt la porte refermée, contraste étrangement avec l'effervescence bruyante de la ville. Les grandes vitres donnent l'impression d'être sans tain, et de pouvoir être témoin de cette agitation sans être vu, d'appartenir déjà, sans même avoir parcouru l'exposition, à ce monde de l'art mis à l'écart, délaissé par le flot consumériste. Coupé du mouvement incessant de la ville, nous rentrons dans l'Espace Écureuil en méditation, comme dans une chapelle égarée dont on ignore encore quels effets elle aura sur notre âme après notre passage.
Dans l'entrée de la galerie, un petit groupe de visiteurs attend patiemment la visite guidée par l'artiste Mona Oren, et chacun se questionne du regard devant le mystère de cette première œuvre du hall intitulée Hourglass : de grands sabliers en verre soufflé, dont les ampoules se rejoignent par un tissage givré, donnent le rythme d'un temps obscur. Mona guette timidement nos interrogations, notre surprise. Il y a une douce fébrilité mêlée au plaisir du partage à venir dans son sourire. Dès ses premiers mots, son accent, que nous serions bien en peine d'interpréter comme celui de ses origines, cette terre d'Israël, berce ce voyage intérieur qu'elle nous invite à suivre. Ses gestes délicats, maîtrisés, accompagnent sa parole pleine d'humilité et d'une candeur presque juvénile. Elle nous confie la naissance onirique de cette première œuvre et détaille sa structure : les sabliers contiennent de l'eau salée et le sel se cristallise le long de la corde pour rejoindre la partie basse. L'œuvre vit, ne cesse d'évoluer, cherche à imposer sa propre cadence. Ce temps-là est le temps des éléments, de la matière, de la nature et de la vie tout entière, donnant son nom à l'exposition : Life Time.
Derrière elle, dans la vitrine de la galerie, deux cocons suspendus par un cordage épais forment un couple dont le genre nous échappe : l'un
montre son squelette fait de grillage, tandis que l'armature métallique
de l'autre est recouverte d'un drapé de cire blanche, comme patiemment tissée par un être surnaturel. Ces deux œuvres dialoguent à distance avec ces deux autres cocons posés devant nous, parmi les sabliers, que l'on pourrait prendre pour leur réplique pour peu que nous fassions abstraction de ce nappage de cristaux de sel qui les pare d'un éclat endiamanté. Ce sertissage naturel, Mona l'a obtenu en trempant ses œuvres dans la mer Morte, par quatre mètres de profondeur, pendant une quinzaine de jours, depuis le radeau de l'Institut de géologie d'Israël avec qui elle collabore depuis plusieurs années. Le sel incrusté dans le grillage du cocon, après oxydation, a pris une couleur de rouille, lui donnant cet aspect de gros sucre d'orge, couleur brune qui virera au noir avec le temps, selon les dires des géologues.
Ces deux cocons, mis en regard avec le couple de la vitrine — qui nous laisse entrevoir la structure de l'œuvre encore immaculée, en train d'éclore, dans le processus de création figé en étapes —, formalisent ainsi une autre échelle de temps instaurée là aussi par la nature elle-même.
 | ||
| Détail de l'exposition ⓒ François Talairach. |
Dans la pièce suivante, Mona raconte l'aventure des Diamants, ces fleurs noires de cire semées là aussi dans la mer Morte, lestées d'un petit plomb et elles aussi cristallisées. C'est une neige des profondeurs qui les recouvre désormais, neige qui ne fond pas, neige saline et qui scelle à jamais cette récolte pacifique, comme si cette mer au nom funèbre avait le don de fleurir une contrée meurtrie par les conflits immuables. Un geste comme un écho à celui d'il y a près de vingt ans, lorsqu'elle avait réalisé cette performance vidéo dans laquelle elle avait fait flotter des pétales de cire blanche à la surface de ce lac immense coincé entre Israël et la Jordanie.
Un peu plus avant dans la galerie, une odeur sucrée, âcre et doucereuse à la fois, l'odeur de l'encaustique, des caves humides jointe à celle des vieux meubles astiqués, s'immisce dans l'air et interroge nos sens. Comme si peu à peu l'espace de l'exposition était gagné par le génie et la passion de l'artiste, c'est tout un pan de mur de 25 m2 qui se trouve enduit d'une couche de cire(2), dans un dégradé allant du blanc à l'ocre. Mona nous invite à poser la main sur cette paroi de chair résineuse, délicate et rugueuse comme la peau d'une crypte cérifère que l'on imagine être l'antre fertile de son univers.
 |
| Dead Sea Project ⓒ François Talairach. |
Au sous-sol, un petit cabinet de curiosités accueille le visiteur où se côtoient divers objets nimbés de cette croûte de sel, où la matière faite bijou se loge dans des écrins, avant qu'il ne s'engouffre dans les deux caves voûtées de la galerie, elles aussi privées de lumière. Là, deux grands écrans projettent, dans un ralenti poussé à l'extrême, des coulées de cire chaude se solidifiant dans l'eau froide. La force hypnotique de cette concrétion organique libère en nous quantité d'autres images, puisant jusque dans la mémoire cachée de nos vies intra-utérines. La visite se clôt dans une petite salle isolée, où un plissé translucide en cire blanche, d'une finesse égale à celle d'une peau, retient notre souffle. Notre contemplation se fige religieusement devant cette étole des anges, auréolée de lumière blanche, qui semble veiller sur le pouvoir de l'artiste.
Mona se dérobe gracieusement sans tarder pour ne pas dénaturer son œuvre, et laisser intact l'émotion qui nous étreint. Alors que nous remontons à la surface et regagnons lentement l'accueil, encore grisés par ce rêve de la matière, un dernier regard alentour, comme pour retenir le mystère, se pose sur des bouquets de tulipes en cire noire ou blanche. Lorsque le monde sombra dans la sidération de cette pandémie et se figea dans l'immobilisme et le repli sur soi, Mona eut l'idée d'un autre champ de fleurs(3), un champ sans limite, détenu par chacun de nous où que nous soyons sur cette terre. Elle sculpta — et continue de le faire à la demande — ces tulipes en cire qu'elle propose d'acheter par quiconque dans le monde, afin de se relier les uns les autres par ce fragile symbole d'espoir. Cet appel, cette main tendue, repoussent ainsi les frontières brutales de ces menaces invisibles et nous libèrent des maux qui planent sur nos vies. Ce geste-là est la preuve ultime que l'art demeure une ressource inépuisable face aux menaces d'un monde en déclin.
(2) « J’ai travaillé au pinceau, avec 8 kilos de cire minérale et 10 kg de cire d’abeille. Ce fut une expérience très forte. »
(3) Le projet se nomme Wax Tulip Mania.