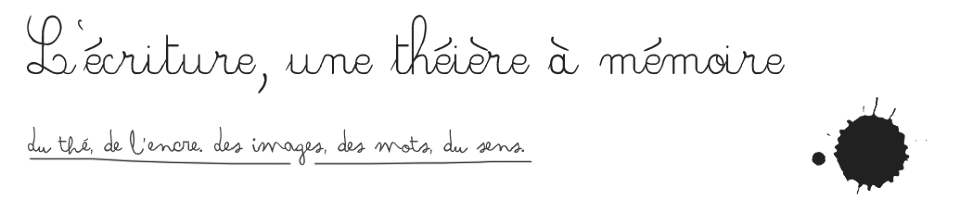Une mise en scène d'Eléna Doratiotto et Benoît Piret.
Je sens bien que je n'en ai pas terminé avec ces caravelles. Elles n'en finiront pas de voguer sur cette mer des émerveillements où se croisent des œuvres hétéroclites, mais qui toutes parlent cette langue sans traducteur, celle qui mène au questionnement et dévoile la vacuité de toute chose, de toute vie. Les bannières de ces caravelles continueront de flotter dans le ciel étoilé de mes nuits théâtrales. Cela peut paraître excessif, mais c'est aussi une façon déguisée et ironique de rendre hommage au sujet principal de cette pièce : le banal.
Il y a bien des écueils à éviter lorsqu'il s'agit de mettre en scène le banal. Le conceptualiser, l'intellectualiser, c'est prendre le risque qu'il se désagrège. À l'inverse, le laisser se déployer dans toute sa généreuse opulence, c'est perdre le spectateur. Il faut s'approcher timidement,
ne pas brusquer les choses. C'est un peu comme une peinture pointilliste :
chaque petite touche compte ; chaque petite touche fait le tout. De peinture, justement, il est question au tout début de cette pièce. Mais remontons seulement le temps de quelques minutes.
Il faut imaginer deux femmes et un homme dans l'attente de quelqu'un. Ils scrutent attentivement l'horizon, là-bas derrière le public. Ils trépignent, se persuadent de voir l'objet de leur excitation puis perdent espoir quand l'un d'eux sonne l'alerte : il arrive. Un voyageur semble se profiler au loin. Les trois s'affairent à nouveau, déplient une petite table, la recouvrent d'une nappe quand une ombre traverse les têtes des spectateurs. L'ombre porte un sac à dos, gravit les trois marches qui mènent au plateau et salue les hôtes. Il s'appelle Andréas. Sa candeur et son étonnement font écho à l'accueil chaleureux qui lui est réservé. Il est un peu des nôtres, notre témoin, notre émissaire envoyé là-bas, dans ce lieu encore impossible à identifier.
En guise de préambule, Mr Obertini lui présente le grand polyptyque du hall d'entrée. Sur quatre murs, quatre toiles relatent la bataille de Cajamarca au cours de laquelle les conquistadors espagnols, conduits par Francisco Pizarro, écrasèrent les Incas et leur chef Atahualpa en 1532. Le soin, l'étude des détails et la passion qui l'anime ne tardent pas à contaminer Andréas et nous donnent à voir clairement ces toiles. Pourtant les murs sont vides. Notre imagination répond à l'émerveillement d'Andréas qui nous convainc de la beauté de cette œuvre.
Au centre de ce lieu se dresse une sorte de grand mât. Peut-être le mât de cette hypothétique caravelle qui ne les conduira nulle part. Il n'a pas de signification propre et Andréas le désignera plus tard comme un
totem. Mais un totem de quoi ! N'est-il pas plutôt une charpente
verticale destinée à soutenir un toit menaçant de s'effondrer ? Ou
peut-être est-ce une construction en lien avec le divin. Quoi qu'il en soit, il est là, au
milieu du lieu, et s'il se dégrade, on le consolide aussitôt. D'ailleurs, les principales occupations sont centrées sur l'entretien du lieu, comme le jardin ou le grenier.
Une fois installé dans ce lieu atypique, sans identité propre, le nouvel arrivant se demande « quand est-ce que ça va commencer ? » Mais commencer quoi ? Andréas est encore pétri de réflexes et d'habitudes de l'autre monde, celui qu'il a quitté en venant ici, dans cette sorte de retraite, de montagne magique(1). La
chose qui lui importe c'est le but, le « faire »,
l'activité. Les premiers jours, il se questionne. Et tous les jours il adresse une lettre, autant à une personne dont nous ignorons l'identité qu'à lui-même, dans laquelle ses mots trahissent d'abord l'étonnement, la curiosité puis, petit à petit, la conviction qu'il est au bon endroit, à sa place.
Sans
qu'il y ait d'énonciations, de discours, de prise de position explicite, il y a
malgré tout une dimension politique sous-jacente, un parfum libertaire.
Ici, point de règles. Exit les lois. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Chacun respecte l'autre dans son
individualité. Et cet espace ouvert est une invitation à le remplir et à se définir. En note d'intention, la troupe cite Heiner Müller : « Créer des foyers pour l'imagination est l'acte le plus politique, le
plus dérangeant que l'on puisse imaginer. » En effet, tout est possible, y compris le renversement des valeurs, des normes établies. Ce lieu sans nom devient le lieu de tous les possibles, de l'utopie, c'est-à-dire de l'hétérotopie, pour reprendre le mot de Michel
Foucault(2).
Ce réel magnifié, sublimé,
épuré du mauvais, de la contrainte, de l'obligation, ce quotidien désincarné ressemble à un rêve. Les personnages sont appliqués,
ils débordent de minutie dans leurs occupations anodines. Elles ne devraient logiquement pas en
demander autant. Ça devient d'abord risible, puis nous sentons bien que ça
pourrait être notre lot quotidien, pour peu que nous nous laissions faire. Que nos
manies ont un peu de cette matière-là.
Les passions qui animent les résidents ne dévoient jamais ni la tranquillité du lieu, ni celle de l'autre. Ou à peine de quoi déclencher une petite bisbrouille. Le seul écart de conduite, auquel nous
n'assisterons pas, et qui restera lui aussi confiné dans notre imagination, est un poing dans la figure. Mais ce tout petit
débordement doublé de son infime colère en deviennent touchants. Ils sont le signe de leur humanité. Leurs émotions peuvent encore les prendre à revers. Ces personnages sont bien
comme nous, même si tout portait à penser le contraire. Une version douce et édulcorée de nous. Ils sont faits de cette pâte propre aux personnages d'Aki Kaurismäki : ces derniers
gentils(3) ne livrent que de petites batailles, juste de quoi mordiller l'autre et lui faire comprendre qu'il existe, qu'il est bien de chair et d'os. Mais n'en demandez pas plus ! Au diable les guerres ! Ils sont au-delà des combats.
De
là vient cette liturgie des perdants, des déshérités, des
laissés-pour-compte. Elle résonne notamment par ce
mot, « Gloire aux vaincus ! », que l'un des pensionnaires, Monsieur Gürkan,
énonce au beau milieu d'un discours, lors d'un simulacre de cérémonie de prix Nobel. Son mot renvoie aux Incas du polyptyque du hall. Mais
il est aussi une manière de se reconnaître et de se célébrer(4). Aucune négativité ne vient ternir cette idée de contre-victoire. Et dans le fond, puisqu'il n'y a ni bataille, ni combat, il ne peut y avoir de vainqueurs ni de vaincus. Et l'autre ne sera jamais un adversaire, ni pour autant un ami. Il est pourtant bien plus qu'un
voisin de chambre, un pensionnaire, un camarade. Tout au plus un compagnon de voyage. Il est la possibilité de s'oublier un peu. Et « s'ignorer soi-même, c'est vivre. »(5) Ce petit groupe vit, et leur caravelle ne cherche aucune terre à conquérir. Ils sont la terre, ils sont le continent. Et la dérive est leur voyage(6).
(1) La pièce s'inspire du roman de Thomas Mann publié en 1924, La Montagne magique.
(2) Concept forgé, en 1967, lors d'une conférence intitulée « Des espaces autres » et qui donne au lieu de l'utopie, une existence réelle, une localisation physique.
(3) À lire également, Les derniers gentils.
(4) « J'emporte avec moi la conscience de ma défaite, comme l'étendard d'une victoire. » Fernando Pessoa, Le Livre de l'intranquilité, 54, page 89, Christian Bourgois Éditeur, 1999. Texte écrit entre 1913 et 1935. Id., 105, page 141 : « Seul sait vaincre celui qui ne gagne jamais. » Et la note 307 : « Faisons de notre échec une victoire (...). »
(5) Id., 39, page 72.
(6) « Nous vivons tous, ici-bas, à bord d'un navire parti d'un port que nous ne connaissons pas, et voguant vers un autre port que nous ignorons. » Id., 208, page 239. Voir aussi la note 125 sur le voyage de la pensée, la note 138 sur le renoncement comme libération et la note 306 : « Nous voilà tous en train de naviguer, sans la moindre idée du port auquel nous devrions arriver. »
 |
| Mme Stöhr (Anne-Sophie Sterck), Mr Obertini (Benoît Piret) et Clawdia (Eléna Doratiotto). |