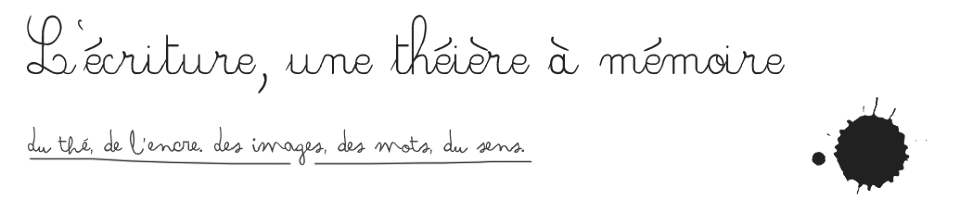En ce soir d'hiver perdu dans sa saison, nos quarante années ne pesaient rien, ne comptaient plus. Nous venions de voir un film de Guillermo del Toro — The Shape of Water —, autrement dit nous sortions d'un univers sans âge, qui nous ramenait à l'émerveillement de nos premières découvertes cinématographiques. L'histoire débordait les cadres et déroulait un amour pur et impossible entre une femme muette emmurée dans son silence, et une créature mi-homme mi-animal, esseulée, traquée. Cette tendresse infinie et surnaturelle née de leur rencontre illuminait cette part juvénile enfouie en nous, tapie dans nos mémoires : nous devions redevenir un peu enfant pour y croire. Et naturellement nous le devenions.
Arrivés à mon appartement, je m'étais glissé un peu vite dans mon lit, non pas que je fusse particulièrement fatigué, mais plutôt parce que je pensais qu'elle ne resterait pas tard. Elle avait toujours un peu de route à faire et la fatigue de son travail avait raison de la tentation de l'oisiveté. Finalement, elle n'était pas décidée à partir. Après ses deux bières et ses trois petits verres de rhum avalés en début de soirée, elle sentait encore trop sa conscience l'étreindre et voulait la faire basculer du côté de l'insouciance. Il lui fallait donc encore un peu d'alcool. Pour l'accompagner, je lui ai demandé de me servir une bière, avec une paille. Ça ne la surprenait même pas. J'aimais ce côté-là chez elle : l'excentricité, l'insolite renfermaient les clés des verrous du monde et même, parfois, les racines d'une poésie qui ne s'écrit pas mais se vit.
Nous avons trinqué en riant, un peu comme si nous n'y étions pas autorisés, ou pas en âge de le faire. Et elle s'est amusée avec sa cigarette à expirer autant de volutes que de réflexions obsédantes. Ses pensées ont empli la chambre d'une gaze de jeune mariée. J'ai commencé à la prendre en photo puis comme souvent dans ce cas, nous avons fini par en jouer jusqu'à ce que son naturel triche un peu avec la pose. Une demi-heure a filé le temps de parfaire le cadrage et l'esthétique afin qu'ils fussent à notre goût. Je sentais bien que ça la distrayait un peu de ses préoccupations. Elle n'arrêtait pas de penser à cette fille avec qui nous avions déjeuné. Le soir venu, toute la pression retombait et il lui restait comme un arrière-goût d'inachevé, la rancœur de n'avoir pas réussi, au cours de ce repas, à être elle-même, solide et imperméable à ses émotions. Je sentais ces choses-là, je lisais sur son visage tous ses questionnements. Elle n'avait pas besoin de m'en faire part, il suffisait que je sois à ses côtés.
Et comme pour figer l'émotion, la sublimer, rendre plus incandescent ce sentiment amoureux qui bataillait avec sa raison, elle a voulu écouter Diabolo menthe, la chanson d'Yves Simon. Mais ce n'était pas lui l'interprète. Je n'ai pas reconnu cette voix féminine dans laquelle se perdait maturité et insouciance. Puis une autre chanson a suivi, par hasard, dans la continuité de la première. Un titre que ni elle ni moi n'avions choisi. Il portait le même nom que cette chanson de Leonard Cohen, Suzanne. D'abord occupés à peaufiner un cliché le plus proche possible de son état d'esprit, nous n'étions pas attentifs aux paroles, juste emportés par la voix et la musique. Sitôt terminée, elle l'a relancée. Puis à nouveau. Trois, quatre, cinq fois. Jusqu'à ce qu'on en vienne enfin à parler de cette chanson, à reprendre certaines paroles : « Qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui m'a pris... un autre vertige. » Le vertige qui se mêle à la peur de la brûlure. Le vertige de l'ignorance, de l'égarement, de l'incertitude. La perte de contrôle. La voix de la chanteuse devenait sa propre voix intérieure et les paroles celles qu'elle savait ne jamais pouvoir lui adresser. La chanson disait la naissance et la fin d'une histoire qui n'avait de sens que pour l'une d'entre elle. « Je sais tu n'existes pas, Suzanne, pourtant je te parle. » Non, cette fille ne s'appelait pas Suzanne mais c'était tout comme.
Je la croyais capable de tout. De se saouler davantage, de passer la nuit dans les bras d'un homme qu'elle finirait par exécrer le lendemain à la lumière du jour, de projeter sa voiture dans le fossé, de sauter un chapitre entier de sa vie à venir. Tout pourvu qu'elle cessa de ressentir le poids de ces interrogations.
Et le Suzanne de la Grande Sophie tout autour de nous comme une bande-son de notre heure adolescente. J'ai fini par croire que cette chanson avait été écrite pour cette soirée particulière, qu'elle était la récompense d'un échange, d'un partage ; ou encore le point ultime, la conclusion d'un épisode tumultueux, à savoir le repas entre elle et cette fille, en ma présence.
Suzanne renfermait une sentence douce amère : celle de devoir être adulte une fois que les rêves, les fantasmes avaient parlé. Comme à chaque fois qu'une chanson qui nous transporte se termine, et qu'il nous reste un goût perpétuel d'inachevé. Son rythme aurait pu battre toute une vie, et ses paroles nous raconter notre existence toute entière. Mais non, quelques minutes puis plus rien. C'est la raison pour laquelle, sitôt les chansons qui la faisaient frissonner sur le point de s'achever, elle les relançait sans tarder. Comme si elle voulait aussi retarder le déclin du soleil à la fin de l'été, lorsque les ombres s'allongent loin devant nous, et qu'elles ne nous appartiennent déjà plus tout à fait.
Je n'ai pas encore fini d'écouter Suzanne. Mais je sais déjà que, lorsqu'elle sera chassée de mon esprit par une autre chanson, ou tout simplement parce que la couche de mes diverses occupations l'aura enterrée, à ce moment précis, elle pourra ressurgir chargée de ce pouvoir évocateur, de ce scintillement propres aux meilleurs souvenirs et me projeter cette soirée dans les moindres détails. Plus encore, elle l'aura magnifiée et gravée dans l'anneau de nos souvenirs communs, nous qui ne sommes pourtant pas mariés et ne le serons jamais.
Arrivés à mon appartement, je m'étais glissé un peu vite dans mon lit, non pas que je fusse particulièrement fatigué, mais plutôt parce que je pensais qu'elle ne resterait pas tard. Elle avait toujours un peu de route à faire et la fatigue de son travail avait raison de la tentation de l'oisiveté. Finalement, elle n'était pas décidée à partir. Après ses deux bières et ses trois petits verres de rhum avalés en début de soirée, elle sentait encore trop sa conscience l'étreindre et voulait la faire basculer du côté de l'insouciance. Il lui fallait donc encore un peu d'alcool. Pour l'accompagner, je lui ai demandé de me servir une bière, avec une paille. Ça ne la surprenait même pas. J'aimais ce côté-là chez elle : l'excentricité, l'insolite renfermaient les clés des verrous du monde et même, parfois, les racines d'une poésie qui ne s'écrit pas mais se vit.
Nous avons trinqué en riant, un peu comme si nous n'y étions pas autorisés, ou pas en âge de le faire. Et elle s'est amusée avec sa cigarette à expirer autant de volutes que de réflexions obsédantes. Ses pensées ont empli la chambre d'une gaze de jeune mariée. J'ai commencé à la prendre en photo puis comme souvent dans ce cas, nous avons fini par en jouer jusqu'à ce que son naturel triche un peu avec la pose. Une demi-heure a filé le temps de parfaire le cadrage et l'esthétique afin qu'ils fussent à notre goût. Je sentais bien que ça la distrayait un peu de ses préoccupations. Elle n'arrêtait pas de penser à cette fille avec qui nous avions déjeuné. Le soir venu, toute la pression retombait et il lui restait comme un arrière-goût d'inachevé, la rancœur de n'avoir pas réussi, au cours de ce repas, à être elle-même, solide et imperméable à ses émotions. Je sentais ces choses-là, je lisais sur son visage tous ses questionnements. Elle n'avait pas besoin de m'en faire part, il suffisait que je sois à ses côtés.
Et comme pour figer l'émotion, la sublimer, rendre plus incandescent ce sentiment amoureux qui bataillait avec sa raison, elle a voulu écouter Diabolo menthe, la chanson d'Yves Simon. Mais ce n'était pas lui l'interprète. Je n'ai pas reconnu cette voix féminine dans laquelle se perdait maturité et insouciance. Puis une autre chanson a suivi, par hasard, dans la continuité de la première. Un titre que ni elle ni moi n'avions choisi. Il portait le même nom que cette chanson de Leonard Cohen, Suzanne. D'abord occupés à peaufiner un cliché le plus proche possible de son état d'esprit, nous n'étions pas attentifs aux paroles, juste emportés par la voix et la musique. Sitôt terminée, elle l'a relancée. Puis à nouveau. Trois, quatre, cinq fois. Jusqu'à ce qu'on en vienne enfin à parler de cette chanson, à reprendre certaines paroles : « Qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui m'a pris... un autre vertige. » Le vertige qui se mêle à la peur de la brûlure. Le vertige de l'ignorance, de l'égarement, de l'incertitude. La perte de contrôle. La voix de la chanteuse devenait sa propre voix intérieure et les paroles celles qu'elle savait ne jamais pouvoir lui adresser. La chanson disait la naissance et la fin d'une histoire qui n'avait de sens que pour l'une d'entre elle. « Je sais tu n'existes pas, Suzanne, pourtant je te parle. » Non, cette fille ne s'appelait pas Suzanne mais c'était tout comme.
Je la croyais capable de tout. De se saouler davantage, de passer la nuit dans les bras d'un homme qu'elle finirait par exécrer le lendemain à la lumière du jour, de projeter sa voiture dans le fossé, de sauter un chapitre entier de sa vie à venir. Tout pourvu qu'elle cessa de ressentir le poids de ces interrogations.
Et le Suzanne de la Grande Sophie tout autour de nous comme une bande-son de notre heure adolescente. J'ai fini par croire que cette chanson avait été écrite pour cette soirée particulière, qu'elle était la récompense d'un échange, d'un partage ; ou encore le point ultime, la conclusion d'un épisode tumultueux, à savoir le repas entre elle et cette fille, en ma présence.
Suzanne renfermait une sentence douce amère : celle de devoir être adulte une fois que les rêves, les fantasmes avaient parlé. Comme à chaque fois qu'une chanson qui nous transporte se termine, et qu'il nous reste un goût perpétuel d'inachevé. Son rythme aurait pu battre toute une vie, et ses paroles nous raconter notre existence toute entière. Mais non, quelques minutes puis plus rien. C'est la raison pour laquelle, sitôt les chansons qui la faisaient frissonner sur le point de s'achever, elle les relançait sans tarder. Comme si elle voulait aussi retarder le déclin du soleil à la fin de l'été, lorsque les ombres s'allongent loin devant nous, et qu'elles ne nous appartiennent déjà plus tout à fait.
Je n'ai pas encore fini d'écouter Suzanne. Mais je sais déjà que, lorsqu'elle sera chassée de mon esprit par une autre chanson, ou tout simplement parce que la couche de mes diverses occupations l'aura enterrée, à ce moment précis, elle pourra ressurgir chargée de ce pouvoir évocateur, de ce scintillement propres aux meilleurs souvenirs et me projeter cette soirée dans les moindres détails. Plus encore, elle l'aura magnifiée et gravée dans l'anneau de nos souvenirs communs, nous qui ne sommes pourtant pas mariés et ne le serons jamais.
 |
| ⓒ Li Hui. |