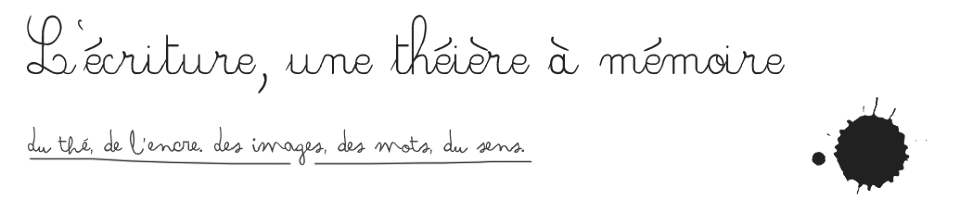Cette musique a toujours été là. Où précisément ? Impossible de le
dire. Mais quelque part en moi. J’étais incapable de la nommer, de la
convoquer, de la reconnaître dans ses moindres flux et reflux inondant la
partition, incapable de mettre un visage sur celui ou celle qui la chantait, incapable même de
chantonner quelque chose, et pour le coup de la partager. Peut-être avais-je
entendu quelques-unes de ses notes tapotées sur une table, un banc, une vitre,
par un étranger, un voisin, un passant. Et puis je reçois une invitation, de la
part d’Alice, à me rendre place du Ravelin, au bar éponyme. Alice, chanteuse du
groupe This Silly Thing, a déposé des
petits cailloux afin que le cavalier solitaire fasse une halte ici. Sur l’affiche, une fumée
noire transpercée de lettres annonce son nom : The Dad Horse Experience.
Le voilà qui sort du bar justement. Un gaillard flanqué d’un corps
comme façonné par le football et la mine – si Raymond Kopa avait été gallois,
peut-être lui aurait-il ressemblé davantage. Il est occupé et à l’aise en même
temps, dynamique et disponible. Il porte un pantalon en toile, une chemise blanche
qui plisse sous ses bretelles apparentes. Les cheveux en bataille, il a le
visage sec et anguleux, passé à l’étuve des concerts égarés, et un sourire grimaçant
calé en coin, presque par coquetterie. Ses oreilles sont comme deux signatures
de polisson échappé de l’East End, faisant de lui un héros secondaire des
romans de Charles Dickens ou Jack London. Dans son regard se lit aussi la malice de ces
gamins resquilleurs mis en scène par Ken Loach. Mais je n’y suis pas. Dirk, oui
il s’appelle Dirk, est allemand. Ni footballeur, ni mineur, Dirk était
chauffeur de taxi avant d’être The Dad
Horse Experience. Son itinérance a probablement poli ses traits et
gommé sa germanité : la froideur des attentes, le poids de ses bagages, la
route rugueuse et inconnue, le vent qui fait s’entrechoquer les lourds étuis à
instruments, les regards curieux, ce public devant lequel prêcher, sans
oublier les ricochets de la langue anglaise.
Après la douce parenthèse folk d’Alice, berceuse des chercheurs d’or et
des cavaliers sans selle imbibés de rêves, Dirk prend place sur la petite
estrade, pas très haute, et commence sa chorégraphie : brancher-ça-ici,
poser-ça-là-sur-le-côté, allumer-ça, caler-la-chaise, se-caler-dessus. Il place
devant un clavier, au sol, une boîte en fer dépoli. Ça ressemble à un vieux
compteur Geiger. Il va capter le vice radioactif, ou la quantité de péchés
accumulés en chacune des personnes présentes. Il fait tout lui-même, il est un roadie,
à la fois artiste et technicien qui reprend la route sitôt le show terminé. Il
jette de petits coups d’œil à son auditoire et son regard est à la fois
malicieux et concentré. Et puis vient le temps de se déchausser.
Pourquoi ? Sûrement être à l’aise, ça lui ressemble. Non. Du bout de ses
chaussettes il caresse rapidement quelques touches de sa basse pédale, fait
quelques kicks en avant histoire de se déraidir les genoux, et vérifier que sa
chaise ou quoi que ce soit d’autre n’entravera pas son jeu.
Je n’ai rien manqué de toute sa préparation et à ce titre je me
persuade que la première chanson m’est dédiée. Mais à peine ai-je le temps de frissonner
aux premières notes des quatre cordes de son banjo qu’un oiseau tombe de nulle
part. Un oiseau blanc, en plastique, entre le goéland et la mouette. Ou bien
est-ce un fulmar boréal. La chanson terminée, je regarde où se trouve le nid de
l’oiseau : sur une étagère, accrochée au mur, laquelle porte aussi une
enceinte. Je comprends que ce sont les vibrations qui l’ont précipité dans le
vide. Il reste un second oiseau sur cette même étagère, un noir cette fois. J’ignore
s’ils viennent des bagages du chanteur ou s’ils logent ici, au Ravelin. Dirk lance sa deuxième chanson
et timidement, l’oiseau noir s’avance près du ravin. Il est presque impossible
de le voir bouger mais il s’avance inexorablement. Je ne suis pas le seul à
l’avoir remarqué. Un gars dans le public s’avance et l’intercepte dans les
airs, juste après son saut. Maintenant que les oiseaux ont pris leur
envol, je prends le mien et ne quitte plus l’artiste.
Dirk envoie valser mon âme des Balkans aux Appalaches, en passant par
l’Irlande. Je ne sais plus totalement où j’habite et mon sang pulse à la
cadence d’un cheval déterminé à garder sa liberté mais diverti aussi par la
nostalgie du chemin parcouru la veille. Je suis la réincarnation de quelques
descendants de l’Ouest américain perdus dans l’Est européen, et bercés par un
blues frotté au banjo ou à la mandoline. Avant d’entamer Kingdom It Will Come, Dirk entortille autour de son cou un kazoo
comme s’il allait rappeler au bercail ses fulmars – ils sont donc bien de son
voyage à lui, ces oiseaux marins, peut-être même ses éclaireurs. Quelques titres plus tard, il
fouille du regard son auditoire à la recherche d’un tatouage sur un bras dénudé, pour introduire sa
prochaine chanson dans laquelle il est question du tatouage que personne ne peut
voir. Du tatouage intérieur, celui que tout le monde a.
I've been putting a tattoo on me
From the inside I can't see
What it is or what it means
I just know the pain that I feel.
Par moments, Dirk braille avec justesse comme un punk éméché un peu trop timide, et
que l’émotion ferait chavirer. Mais son émotion à lui est l’écho de notre
émotion, souvent prête à bondir, lorsque nous cherchons du réconfort, auprès
des autres, dans les vapeurs de l’alcool qui inondent les sous-sols de nos occupations
sédentaires. Puis le refrain s’éteint doucement, et Dirk tient à nouveau les
rênes de ses élans, de son chant qui reprend la route de la confession, de la
complainte. Il nous rappelle qu’il est le témoin privilégié de nos égarements. De
sa musique naît un hymne des zones d’ombre de notre esprit qui sont autant de rues adjacentes à l’abandon, de banlieues symboliques que nous
n’osons fréquenter.
Si les voyelles de Rimbaud ont des couleurs, Dirk donne du noir et
blanc aux consonnes, aux lettres sourdes. Du noir et blanc comme à ces deux
fulmars tombés du ciel. Puisque c’est bien de ça qu’il s’agit. Du Ciel, avec une majuscule s'il-vous-plaît. Dirk appelle sa musique le Kellergospel(2), le Gospel des caves, des
bars, des souterrains, des lieux où personne ne songe, a priori, à la
spiritualité, bien trop occupés que nous sommes à tenter de nous libérer de
tout ce qui, de près ou de loin, nous enchaîne. Sauf qu’ici peut-être plus qu'ailleurs, enclins à nous livrer, serions-nous prêts aussi à entendre autre chose. Un discours qui frôle le divin par exemple. Et si cette musique a toujours été là, c’est parce qu’elle a
accompagné mes questionnements. Elle est la musique de nos questionnements. Est-ce
que Dieu existe ? Est-ce qu’il y a un paradis, un enfer ? Est-ce que
si je prie, sans foi, je serai sauvé ? Est-ce que je peux prier pour
avoir la foi ? Est-ce que si ma vie est un enfer, je ferai parti des élus ?
Est-ce que je serai quelqu’un avant de mourir ?
Will
I Be someone before I die
Will
I be someone
When
I walk into the dark night (into the dark night)
Will
I be someone before I die
A dot
of ink in God's blue sky
A tattoo myself, fading away.
Dirk sait que ce sont des questionnements qui, loin d’interrompre notre
vie prosaïque et décousue, prennent parfois un peu trop la poussière, faute de
réponse, tandis que nous entrechoquons nos verres et faisons résonner les caves
comme autant de cryptes profanes.
(1) Will I Be Someone de l'album Eating Meatballs on a Blood-Stained Mattress in a Huggy Bear Motel.
(2) « Keller is the
German word for “basement” or “cellar,” so it’s gospel music in a way. It’s
easy to preach gospel in the church, where everybody has their torch burning,
but the Keller Gospel is intended to be played in the darker places. I used to
play in bars, which aren’t automatically attached to gospel music and I tried
to put it in tunes and lyrics that would help people be interested in it. » (Slug
Magazine, oct. 2013)