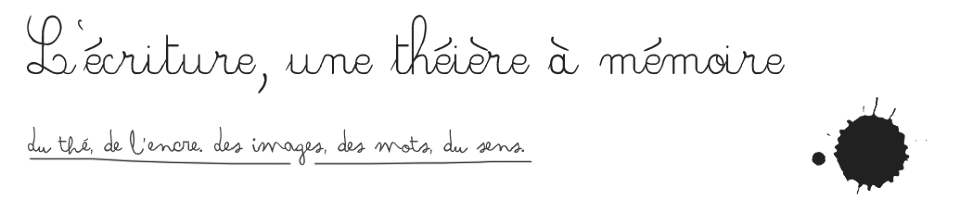Avant la retraite (Vor dem Ruhestand) de Thomas Bernhard
Le théâtre* n'est plus le même. Je ne reconnais pas le lieu que je fréquente habituellement. Des murs de planches de bois resserrent l'espace et tentent d'absorber le public qui s'installe ; ces murs ont déjà englouti quelques rangées des parterres pair et impair. Il est même impossible de s'assoir sur certains fauteuils dont la découpe des planches les tranche au cœur. Mais ce n'est pas tout. Ces deux murs opposés tentent aussi de se rejoindre au fond de la scène donnant à l'espace une perspective étouffante tout en distordant le temps : nos repères sont brouillés dans cette fuite de l'observation et notre distraction ressemble davantage à une convocation.
Une odeur à peine perceptible de résineux flotte dans l'air et nous transporte à la lisière d'une forêt autrichienne. J'ai le sentiment que nous nous asseyons dans un immense cercueil dont le gigantisme renvoie à la monstruosité de celui à qui il est destiné : le Reichsfürher-SS Heinrich Himmler. Le corps du bourreau, lui, est bien là, dans l'entrée de la salle. Il repose au fond d'une cage de verre remplie d'eau et un système d'oxygénation donne à l'ensemble un air d'aquarium. Des bulles éclatent joyeusement à la surface après leur remontée, et ce bruit de laboratoire nous pousse à croire que quelqu'un tente encore de le maintenir en vie.
Dans un coin de la scène, un fauteuil roulant épouse parfaitement une petite découpe rectangulaire dans le mur de bois. Il est de dos et l'ombre avale le visage de celle qui l'occupe. Vera entre en scène, entame son monologue, tout en dégageant sa sœur infirme, Clara, du coin d'où elle semblait punie. Vera est la femme d'un ancien SS, Rudolph Höller, qui a échappé aux procès d'après-guerre et, ironie glaçante, est devenu juge dans sa ville. À l'aube de sa retraite, il célèbre, comme chaque année, le jour de la naissance de son sauveteur et maître à penser : Heinrich Himmler. Par cette commémoration secrète, il ressuscite ce fantôme et ses thèses liberticides, tout en revivant son glorieux et macabre passé. Le dramaturge autrichien Thomas Bernhard, l'auteur de cette pièce, est parti d'un fait divers pour dénoncer l'idéologie nauséabonde qui envenime et pervertit encore la société de son pays. Cette attaque provoquera un nouveau scandale à sa sortie, en 1979.
Une odeur à peine perceptible de résineux flotte dans l'air et nous transporte à la lisière d'une forêt autrichienne. J'ai le sentiment que nous nous asseyons dans un immense cercueil dont le gigantisme renvoie à la monstruosité de celui à qui il est destiné : le Reichsfürher-SS Heinrich Himmler. Le corps du bourreau, lui, est bien là, dans l'entrée de la salle. Il repose au fond d'une cage de verre remplie d'eau et un système d'oxygénation donne à l'ensemble un air d'aquarium. Des bulles éclatent joyeusement à la surface après leur remontée, et ce bruit de laboratoire nous pousse à croire que quelqu'un tente encore de le maintenir en vie.
Dans un coin de la scène, un fauteuil roulant épouse parfaitement une petite découpe rectangulaire dans le mur de bois. Il est de dos et l'ombre avale le visage de celle qui l'occupe. Vera entre en scène, entame son monologue, tout en dégageant sa sœur infirme, Clara, du coin d'où elle semblait punie. Vera est la femme d'un ancien SS, Rudolph Höller, qui a échappé aux procès d'après-guerre et, ironie glaçante, est devenu juge dans sa ville. À l'aube de sa retraite, il célèbre, comme chaque année, le jour de la naissance de son sauveteur et maître à penser : Heinrich Himmler. Par cette commémoration secrète, il ressuscite ce fantôme et ses thèses liberticides, tout en revivant son glorieux et macabre passé. Le dramaturge autrichien Thomas Bernhard, l'auteur de cette pièce, est parti d'un fait divers pour dénoncer l'idéologie nauséabonde qui envenime et pervertit encore la société de son pays. Cette attaque provoquera un nouveau scandale à sa sortie, en 1979.
La « Sonate Clair de lune » de Beethoven annonce l'inhumaine mascarade. La musique avance comme une funeste marche tandis que Vera déshabille Clara pour la revêtir du douloureux habit, la tenue rayée des camps de concentration, qui symbolise tout ce qu'exécrait le régime nazi, et la préparer ainsi au jeu à venir. Rudolph sort de l'ombre paré de son uniforme immaculé, et chacun se met en place. L'exutoire de la fête les plongera dans l'esprit du mal qui dévore leur âme, et la bestialité de Rudolph apparaîtra au grand jour. Mais le défoulement, la jubilation de pouvoir enfin être à nouveau ce qu'ils ont été, lorsque la flamme du nazisme brûlait encore, ne dure qu'un temps. Et la fin du jour, se confondant avec la fin de leur petite pièce de théâtre, annonce le terme d'une fausse carrière, autre mascarade. Rudolph ne sera plus caché derrière sa fonction de juge et perdra toute considération et tout pouvoir. La retraite préfigure la petite mort.
L'adagio du concerto pour clarinette en la majeur K. 622 de Mozart, vient alors bercer timidement le terrible songe de l'ancien nazi, et tente de le consoler de cette perte qu'il sent approcher. Porté et aveuglé par cette harmonie musicale et ses souvenirs, Rudolph pousse Clara dans la fosse, si proche de nous, comme si son travail d'extermination n'avait jamais cessé. Tapis derrière la douceur de la mélodie, il faut tendre l'oreille pour discerner les bruits de bottes de la cruauté et de l’infamie, qui semblent se calquer sur le rythme de la musique. Les monstres, lestés de leur haine, savent aussi alléger leurs pas. Mais lorsque le rideau de fer du crépuscule voile leur horizon, il se pourrait bien que ces salauds ne dorment plus en paix.
*Le théâtre Sorano.
L'adagio du concerto pour clarinette en la majeur K. 622 de Mozart, vient alors bercer timidement le terrible songe de l'ancien nazi, et tente de le consoler de cette perte qu'il sent approcher. Porté et aveuglé par cette harmonie musicale et ses souvenirs, Rudolph pousse Clara dans la fosse, si proche de nous, comme si son travail d'extermination n'avait jamais cessé. Tapis derrière la douceur de la mélodie, il faut tendre l'oreille pour discerner les bruits de bottes de la cruauté et de l’infamie, qui semblent se calquer sur le rythme de la musique. Les monstres, lestés de leur haine, savent aussi alléger leurs pas. Mais lorsque le rideau de fer du crépuscule voile leur horizon, il se pourrait bien que ces salauds ne dorment plus en paix.
*Le théâtre Sorano.
À lire également, le portrait de Solange Oswald.
 |
| Rudolph Höller (Georges Campagnac). |