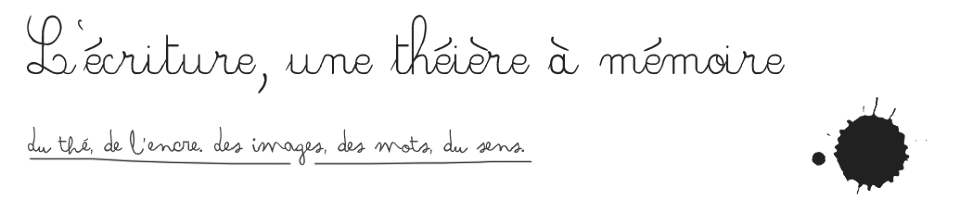Ça ressemblait d'abord à une rumeur qui circulait de proche en proche. Nous avions peine à y croire même si les sirènes n'en finissaient pas de résonner au loin, l'agitation de s'amplifier, l'air de s’appesantir. D'après cette rumeur effrayante, certains d'entre nous étaient déracinés, délogés de force et projetés dans les airs. Ce drame avait pris racine dans une lutte, une révolution, un soulèvement du pays tout entier. Malgré tout, la menace d'une telle violence ne semblait pas encore atteindre notre quartier. Rien ne se profilait d'aussi grave là où je logeais, avenue de Wagram. Certes, le tonnerre grondait, et je croyais entendre cette colère tressaillir jusqu'à nous, au-dessus de la couche de ce qui n'est pas censé bouger, sauf par temps de cataclysme naturel. Mais la révolte pleuvait plus loin, l'incendie brûlait de l'autre côté de la Seine, dans le quartier Latin. Enfin, il y eut le silence. Les autorités avaient recouvert les nôtres par une couche de bitume. Plus de révolte, mais à quel prix ! Celui de notre disparition.
Puis nous avons fini par y croire un peu plus à cette rumeur. Les temps changeaient. D'imperceptibles signes, à notre modeste échelle, glissaient dans les interstices de notre immobilité : quelque chose dans le mouvement, dans la mode, dans le langage de ceux qui n'étaient pas nés comme nous dans la roche. Un décalage dans leur façon d'être, une sorte de faille sismique dans leur société, qui aurait surgi bien après le grondement, et sans même se ressentir. Puis encore un silence, plus long cette fois, d'un demi-siècle à quelques mois près.
Est-ce qu'il avait fallu précisément cinquante années, à cette rumeur, pour venir jusqu'à nous ? Avait-elle progressé au rythme d'un millimètre par jour ? S'était-elle égarée dans le labyrinthe parisien avant de nous rejoindre ? Quelle que fût la nature de son périple, toutes les prémices d'une nouvelle catastrophe se profilaient. En quelques heures, ce samedi-là, nous nous sommes retrouvés au centre d'un conflit, avec de chaque côté deux camps masqués qui s'affrontaient. L'Arc de Triomphe, notre horizon depuis notre arrivée à Paris un siècle auparavant, était désormais barré par une rangée d'hommes en bleu. Devant eux, un nuage dense et opaque emplissait l'atmosphère à mesure que des capsules de caoutchouc éclataient après qu'elles aient ricoché sur nos têtes. Chacun de nous les renvoyait, sans bouger, juste parce qu'il offrait une résistance au projectile au moment précis où celui-ci achevait sa chute. Et le choc de la rencontre entre cette chose de plastique remplie de gaz et notre roche, produisait un son qui avait le don d'irriter le camp adverse.
De ma courte vie parisienne, courte à l'échelle du granit, je n'ai qu'une seule fois, eu l'occasion de goûter de quoi sont faits les êtres qui ont présidé à ma destinée. Cette goutte de sang d'un enfant était mêlée à l'amertume de ses pleurs dont le nez saignait suite à sa chute. L'immuabilité de notre condition rocheuse avait stoppé net l'élan du garçon, dont la marche instable heurta une légère aspérité de l'un d'entre nous. Ce petit garçon souffrait en partie par notre faute. Et ma curiosité de pouvoir goûter enfin à la nature de ces êtres, avait pâti de la tristesse d'être la cause de son malheur. Je l'ignorais encore à cette époque, mais je ne pus réellement me faire une idée précise de ce liquide carmin, puisqu'il était dilué aux larmes. Sa saveur métallique en fut atténuée. Tout cela, je l'ai compris bien plus tard, au plus fort de la révolte.
Puis nous avons fini par y croire un peu plus à cette rumeur. Les temps changeaient. D'imperceptibles signes, à notre modeste échelle, glissaient dans les interstices de notre immobilité : quelque chose dans le mouvement, dans la mode, dans le langage de ceux qui n'étaient pas nés comme nous dans la roche. Un décalage dans leur façon d'être, une sorte de faille sismique dans leur société, qui aurait surgi bien après le grondement, et sans même se ressentir. Puis encore un silence, plus long cette fois, d'un demi-siècle à quelques mois près.
Est-ce qu'il avait fallu précisément cinquante années, à cette rumeur, pour venir jusqu'à nous ? Avait-elle progressé au rythme d'un millimètre par jour ? S'était-elle égarée dans le labyrinthe parisien avant de nous rejoindre ? Quelle que fût la nature de son périple, toutes les prémices d'une nouvelle catastrophe se profilaient. En quelques heures, ce samedi-là, nous nous sommes retrouvés au centre d'un conflit, avec de chaque côté deux camps masqués qui s'affrontaient. L'Arc de Triomphe, notre horizon depuis notre arrivée à Paris un siècle auparavant, était désormais barré par une rangée d'hommes en bleu. Devant eux, un nuage dense et opaque emplissait l'atmosphère à mesure que des capsules de caoutchouc éclataient après qu'elles aient ricoché sur nos têtes. Chacun de nous les renvoyait, sans bouger, juste parce qu'il offrait une résistance au projectile au moment précis où celui-ci achevait sa chute. Et le choc de la rencontre entre cette chose de plastique remplie de gaz et notre roche, produisait un son qui avait le don d'irriter le camp adverse.
De ma courte vie parisienne, courte à l'échelle du granit, je n'ai qu'une seule fois, eu l'occasion de goûter de quoi sont faits les êtres qui ont présidé à ma destinée. Cette goutte de sang d'un enfant était mêlée à l'amertume de ses pleurs dont le nez saignait suite à sa chute. L'immuabilité de notre condition rocheuse avait stoppé net l'élan du garçon, dont la marche instable heurta une légère aspérité de l'un d'entre nous. Ce petit garçon souffrait en partie par notre faute. Et ma curiosité de pouvoir goûter enfin à la nature de ces êtres, avait pâti de la tristesse d'être la cause de son malheur. Je l'ignorais encore à cette époque, mais je ne pus réellement me faire une idée précise de ce liquide carmin, puisqu'il était dilué aux larmes. Sa saveur métallique en fut atténuée. Tout cela, je l'ai compris bien plus tard, au plus fort de la révolte.
La nappe de gaz, prête à envelopper la furie des hommes, roulait droit dans ma direction, et repoussait la contestation par son caractère lacrymal. C'est à ce moment-là que je sentis une larme me tomber dessus et découvris la salinité de son essence. Probablement que le nuage nocif avait agi comme un catalyseur puisque certains d'entre les révoltés ont commencé à nous prélever de la route, dans un fracas assourdissant, à l'aide d'une barre de fer. Des étincelles jaillissaient et je crus revivre mon arrachement à la terre des Vosges. Les premiers d'entre nous ont été jetés sur les hommes en bleu, puis d'autres sur des vitrines ou des voitures. Voilà de quoi était faite cette fameuse rumeur dont nous avions tous entendu parler. Ma nouvelle destinée dépendait donc cette fois d'un seul homme et elle n'offrait que deux alternatives : la destruction ou la meurtrissure. Un bruit sec, proche de celui que pouvait faire les capsules de caoutchouc remplies de gaz, partit du camp bleu et vint percuter le visage d'un de ceux qui nous lançaient dans les airs. Un tumulte mêlé de cris provoqua un petit attroupement et je reçus pour la deuxième fois de mon existence quelques gouttes de ce fameux sang. Son goût âcre ressemblait autant à l'outil qui m'avait façonné il y a un siècle, qu'à celui qui tentait de m'extraire de mon lit ancestral. J'eus, ainsi, la confirmation qu'il y avait de l'acier dans ces êtres. Après une pause, un seul d'entre eux osa s'aventurer près du trou creusé dans la chaussée, et parmi ceux d'entre nous qui étions libres de toute attache, ce fut moi que l'homme choisit comme projectile.
Je n'avais pas senti la chair humaine depuis ce jour où l'on m'avait figé dans l'avenue de Wagram. Les mains de ce travailleur étaient alors calleuses et ridées. Celles de celui qui me lança dans les airs en étaient aux antipodes. J'eus à peine le temps de me repérer dans l'espace que je percutai le bouclier d'un homme en bleu, et achevai ma trajectoire au milieu de la route. Le silence qui ponctua ce geste renforça le sentiment de vacuité qu'il renfermait : à quoi tout cela pouvait-il bien conduire ? Est-ce que, sans avoir blessé quelqu'un, mon extraction et mon vol avait servi la cause de son initiateur ? Je m'étais rapproché de quelques mètres de mon horizon et l'Arc de Triomphe me paraissait maintenant plus grand. Je fus par la suite poussé vers d'autres qui avaient subi le même sort que moi. Pour ma part, je n'avais souffert aucun dommage, ce qui n'était pas le cas de mes congénères : il manquait des éclats à certains, d'autres étaient noircis par le feu d'une barricade, ou encore tout maquillés de peinture jaune ou rouge. Un petit nombre voyait sa vie parisienne définitivement achevée puisque la violence qu'ils avaient subie les avait brisés en deux ou trois morceaux inégaux. Ce chaos nous rappelait là encore nos origines, la terre de nos ancêtres.
Nous étions passés le temps d'une projection, dans l'autre camp masqué. Mais l'agitation demeurait. Et rien ne pouvait nous rassurer tant que les esprits peinaient à s'apaiser. Nous sentions jusque dans notre pierre la possibilité d'une récidive. Puis la nuit vint couvrir le tumulte. Les nuages de fumée se dissipèrent. L'ordre s'établissait à nouveau, mais cette fois avec une stupeur qui le rendait fébrile. La capitale retrouvait son pouls plus régulier bien qu'il fût aussi rapide que celui d'un nouveau-né, et ses habitants tentaient de maintenir à tout prix son fragile endormissement.
Je n'avais pas senti la chair humaine depuis ce jour où l'on m'avait figé dans l'avenue de Wagram. Les mains de ce travailleur étaient alors calleuses et ridées. Celles de celui qui me lança dans les airs en étaient aux antipodes. J'eus à peine le temps de me repérer dans l'espace que je percutai le bouclier d'un homme en bleu, et achevai ma trajectoire au milieu de la route. Le silence qui ponctua ce geste renforça le sentiment de vacuité qu'il renfermait : à quoi tout cela pouvait-il bien conduire ? Est-ce que, sans avoir blessé quelqu'un, mon extraction et mon vol avait servi la cause de son initiateur ? Je m'étais rapproché de quelques mètres de mon horizon et l'Arc de Triomphe me paraissait maintenant plus grand. Je fus par la suite poussé vers d'autres qui avaient subi le même sort que moi. Pour ma part, je n'avais souffert aucun dommage, ce qui n'était pas le cas de mes congénères : il manquait des éclats à certains, d'autres étaient noircis par le feu d'une barricade, ou encore tout maquillés de peinture jaune ou rouge. Un petit nombre voyait sa vie parisienne définitivement achevée puisque la violence qu'ils avaient subie les avait brisés en deux ou trois morceaux inégaux. Ce chaos nous rappelait là encore nos origines, la terre de nos ancêtres.
Nous étions passés le temps d'une projection, dans l'autre camp masqué. Mais l'agitation demeurait. Et rien ne pouvait nous rassurer tant que les esprits peinaient à s'apaiser. Nous sentions jusque dans notre pierre la possibilité d'une récidive. Puis la nuit vint couvrir le tumulte. Les nuages de fumée se dissipèrent. L'ordre s'établissait à nouveau, mais cette fois avec une stupeur qui le rendait fébrile. La capitale retrouvait son pouls plus régulier bien qu'il fût aussi rapide que celui d'un nouveau-né, et ses habitants tentaient de maintenir à tout prix son fragile endormissement.
Le temps des questionnements succéda à l'hébétude. Qu'allait-il advenir de nous, les déracinés ? J'avais entendu dire qu'il était possible de nous acheter et de croupir dans une bibliothèque. Je ne m'imaginais pas passer des décennies collé à un livre sans pouvoir ni sentir ni vivre l'aventure qu'il renfermait. Ce n'est pas dans ma nature de récolter la poussière. Non plus que de me blottir dans le confort d'un appartement de ces êtres tiraillés entre conservatisme et modernité. J'appartiens à la nature, c'est elle qui me donne ma raison d'être.
Au cours de la nuit, les révoltés firent place aux apaisés qui s'activèrent pour effacer les traces des premiers. Il y eut un tri parmi nous et ceux qui étaient intacts furent entassés dans un coin avec une délicatesse toute relative, au contraire des écorchés, promptement jetés dans une benne à roues. Un peu plus tard, un autre camion vint nous récupérer et nous remontâmes l'avenue de Wagram. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque nous dépassâmes l'endroit de mon assignation citadine ! Le petit cratère était déjà rebouché et le ciment frais séchait entre les nouveaux pensionnaires du lieu.
Un moineau osa timidement un chant, préfigurant la levée du jour. Le petit camion stoppa au bout de l'avenue, à l'entrée de la place des Ternes. Puis nous fûmes débarqués avec soin avant de prendre place dans un trou, autre marqueur de la bataille passée. Le ciel s'éclaircissait nettement avec ses teintes rosées des beaux jours lorsque la blessure de la chaussée fut entièrement pansée. Le camion reprit sa route et me dégagea ainsi la vue. Je ne voyais plus l'Arc de Triomphe, ce symbole de la République. Mon horizon s'ouvrait sur un espace fermé, un modeste croisement de rues parsemé de quelques arbres et environné de commerces.
J'ignore la nature des prochains événements mais une question me tiraille, nous tiraille tous autant que nous sommes : est-ce qu'il y aura une seconde vague d'asphaltisation ? Est-ce que, pour éviter toute révolte, nous serons recouverts d'une couche de bitume comme ce fut le cas pour ceux du quartier Latin ? Devant ces sombres perspectives, je me tourne vers la seule certitude enracinée en moi : je suis et resterai un fragment de cette grande masse d'où j'ai été extrait. Tiré de ce néant comme d'un sommeil sans fin, j'appartiens désormais à l'histoire, que je le veuille ou non.
Au cours de la nuit, les révoltés firent place aux apaisés qui s'activèrent pour effacer les traces des premiers. Il y eut un tri parmi nous et ceux qui étaient intacts furent entassés dans un coin avec une délicatesse toute relative, au contraire des écorchés, promptement jetés dans une benne à roues. Un peu plus tard, un autre camion vint nous récupérer et nous remontâmes l'avenue de Wagram. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque nous dépassâmes l'endroit de mon assignation citadine ! Le petit cratère était déjà rebouché et le ciment frais séchait entre les nouveaux pensionnaires du lieu.
Un moineau osa timidement un chant, préfigurant la levée du jour. Le petit camion stoppa au bout de l'avenue, à l'entrée de la place des Ternes. Puis nous fûmes débarqués avec soin avant de prendre place dans un trou, autre marqueur de la bataille passée. Le ciel s'éclaircissait nettement avec ses teintes rosées des beaux jours lorsque la blessure de la chaussée fut entièrement pansée. Le camion reprit sa route et me dégagea ainsi la vue. Je ne voyais plus l'Arc de Triomphe, ce symbole de la République. Mon horizon s'ouvrait sur un espace fermé, un modeste croisement de rues parsemé de quelques arbres et environné de commerces.
J'ignore la nature des prochains événements mais une question me tiraille, nous tiraille tous autant que nous sommes : est-ce qu'il y aura une seconde vague d'asphaltisation ? Est-ce que, pour éviter toute révolte, nous serons recouverts d'une couche de bitume comme ce fut le cas pour ceux du quartier Latin ? Devant ces sombres perspectives, je me tourne vers la seule certitude enracinée en moi : je suis et resterai un fragment de cette grande masse d'où j'ai été extrait. Tiré de ce néant comme d'un sommeil sans fin, j'appartiens désormais à l'histoire, que je le veuille ou non.
 |
| Le 02/12/2018. Paris, XIIIe arrondissement ⓒ Sylvie Carte. |