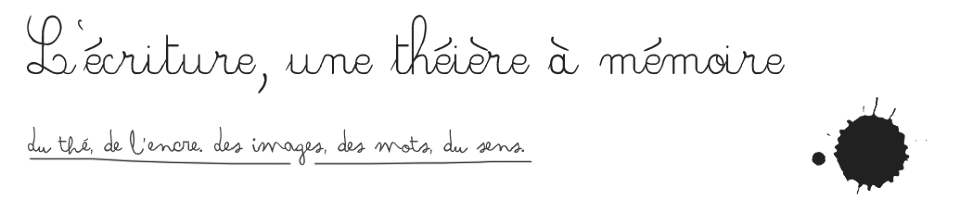Dès mes premières lectures, ou plus exactement depuis mes premiers émois inspirés par la littérature — c'est-à-dire à l'adolescence —, au commencement de cette fascination qu'elle n'a jamais cessé d'exercer, soumettant mon âme à sa tutelle, à son pouvoir sans cesse renouvelé, j'avais porté une attention toute particulière, un soin exagéré au livre lui-même, à l'objet en tant que tel, persuadé qu'il détenait une part importante des raisons pour lesquelles mon être tout entier s'en remettait à son contenu. Objet sacré, il me semblait que la délicatesse avec laquelle je le maniais allait de pair avec le respect des mots qu'il renfermait, et plus généralement, avec le respect de l'œuvre et de l'auteur. Un peu comme un enfant redouterait la moindre détérioration de ses jouets fétiches, mes livres devaient rester comme neufs et ce, même après les avoir lus.
J'avais poussé le vice jusqu'à recouvrir la tranche de la première et de la quatrième de couverture de tous mes livres d'une bande de ruban adhésif, justement pour prévenir tout accident, et renforcer la coque de ces navires miniatures qui me portaient sur toutes les mers de l'imagination. Comme le marin calfate son embarcation ou bien à la manière de ce grand sportif qui entoure d'un bandage sa main ou son pied déjà fragilisé et qu'il sait devoir protéger des assauts d'une épreuve à venir.
Mais à la longue, j'ai fini par remarquer que non seulement ces pansements n'évitaient pas les écornements mais que, lorsque ceux-ci survenaient malgré mon soin obsessionnel, la pliure, la plaie en était renforcée au plus profond de sa chair, au point d'en devenir comme une malformation congénitale. Puis le temps se chargea de souligner avec ironie mon idée saugrenue. Je constatai, à mon grand désespoir, qu'une fine pellicule de poussière venait s'agglomérer sur le bord externe du ruban adhésif, alors que je prenais soin de rendre celui-ci le plus transparent possible en le grattant avec mon ongle. Ainsi, tous mes efforts pour le protéger ne faisaient que pointer du doigt ma lubie excentrique et la rendre futile, dérisoire, inopérante. J'en vins tout naturellement à la conclusion que si je voulais qu'ils restent intacts, je n'avais d'autre choix que de retarder le moment de les lire, contemplant mes acquisitions et goûtant par anticipation leur saveur à proportion de leur jeunesse — autrement dit, plus un livre était neuf et plus le désir de le lire était grand, ce qui paradoxalement avait pour effet de retarder le moment de sa découverte. Et quand j'avais épuisé l'anticipation au point qu'elle ne me nourrisse plus assez, que l'envie de la découverte dépassait le risque encouru, je finissais par céder en prenant toutes les précautions du monde pour l'ouvrir.
Bien évidemment, ce moment impliquait une gestuelle précise et un environnement propre. Il me fallait le manier comme une relique et je n'écartais jamais à l'excès la tranche quand bien même l'ouvrage particulièrement rigide résistait à mon timide assaut. L'origine de ce trait de personnalité provenait d'un atavisme paternel qui ne se limitait pas uniquement aux livres, mais à bon nombre d'objets du quotidien allant de la vaisselle aux outils, en passant par la voiture ou les vêtements et gagnant même le lieu d'habitation tout entier. Pour autant, il ne me serait jamais venu à l'esprit de caractériser mon père ni mes aïeuls de “matérialistes”, loin de là. Ne rentrait dans ce respect, cette sollicitude des choses matérielles aucune considération tendancieuse ou déviante, aucune avarice, ni surévaluation par rapport aux choses spirituelles. Il s'agissait plutôt d'une nature, d'un comportement qui allait de soi pour eux, quelque chose d'inné dans cette façon d'user, de ranger, de nettoyer tout ce qu'ils touchaient ou tout ce qui peuplait leur monde. J'avais donc probablement hérité de cette façon soigneuse et attentionnée d'envelopper mes biens matériels, et ma mère, aux antipodes de ces conduites scrupuleuses, s'amusait de mon vice, sans jamais le railler, ni le dénigrer, mais plutôt en l'observant avec une certaine tendresse, en la détaillant comme les mœurs d'une culture opposée à la sienne.
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré peu de personnes qui avaient cette même manie. La plupart considérait au contraire qu'il faisait partie de la vie du livre de subir les négligences de ses lecteurs, que c'était même la preuve qu'il avait porté ses fruits. Comble d'ironie, je trouvais beaux certains livres aux pages froissées, racornies, délavées, jaunies par l'âge, asséchées et cartonnées par le sel de mer ou les expositions trop prolongées au soleil, crissantes sous les grains de sable, grasses et fibreuses des atmosphères confinées, exhalant des odeurs de grenier, de vieilles malles, de parfums tenaces(1). Derrière ces témoignages sensoriels, il y avait plus que le livre. L'objet devenait un écrin mystérieux qui détenait une part de ses lecteurs et de leur vécu. Ce complément de vie qui prenait possession du livre et sur lequel l'auteur n'avait aucun pouvoir, me donnait l'impression d'entrer en contact avec un parent éloigné, par le hasard d'une envie commune de découvrir la même œuvre. Et comme si cela majorait la curiosité envers cette œuvre, une sorte d'impératif se joignait à mon désir et achevait de briser toutes les barrières qui jusque-là me retenaient d'ouvrir l'ouvrage.
Quand je parvenais enfin à terminer la lecture d'une de ces œuvres, elle retournait dans la bibliothèque, presque inaltérée, ou du moins sans qu'aucun des infimes stigmates de mes nombreuses, mais non moins délicates, manipulations puissent trahir ma lecture. Mais elle n'était pas à l'abri du danger pour autant. Si j'avais eu le malheur de me délecter du texte, je ne manquais pas d'en faire l'éloge auprès de mon entourage. Et sans prendre garde aux conséquences, je vantais avec force arguments les mérites du livre jusqu'à provoquer un désir irrépressible chez mon interlocuteur. Au moment où je l'entendais prononcer la phrase : “tu m'as donné envie de le lire !”, je ressentais la satisfaction de l'avoir convaincu, la joie du partage à venir et donc la nécessité impérieuse, le devoir de lui fournir sur le champ l'objet de notre échange. Si bien qu'au plaisir se mêlait quasi instantanément le regret du prêt inévitable, sans pouvoir maîtriser la peur qu'il ne me revienne en l'état.
Je prenais soin de le mettre en garde, sans trop en rajouter, et je faisais mes adieux au livre en mon for intérieur, bafouant presque l'enthousiasme avec lequel je lui avais vendu l'œuvre. Puis je cherchais à convertir mon regret en tentant de deviner si le plaisir qu'il allait en tirer méritait un tel sacrifice. Ou bien je me rassurais en me disant que s'il me revenait en mauvais état, ou même légèrement défraîchi — ce dont j'étais persuadé, à moins de le prêter à un ami aussi méticuleux que moi — ce serait l'occasion de le racheter neuf et de pouvoir prêter l'ancien sans plus me soucier de son état. Ou mieux encore, s'il avait eu un véritable coup de cœur, j'insistais pour lui offrir, arguant avec une douce hypocrisie que cela me faisait plaisir ou encore que j'avais trop de livres chez moi.
Alors, bien sûr, il était possible de gloser à souhait sur les raisons de ce soin exagéré, en supposant que le mimétisme générationnel ne soit pas une raison suffisante pour convertir tous les descendants : après tout mes sœurs n'étaient pas touchées par ce penchant monomaniaque, bien au contraire. Mais à travers mes nombreuses séances d'analyse thérapeutique, j'avais fini par déterminer un trait de caractère qui pouvait en être la cause : cette tendance à vouloir que rien ne bouge, que tout reste intact. Et en cherchant à comprendre les raisons de cette tendance, la première chose qui me venait se fixait inlassablement sur la peur de la mort. Que rien ne bouge pour protéger du temps qui dévore tout. Au hasard de mes lectures, je tombai sur cette phrase d'Irvin Yalom qui résumait mieux encore toute la problématique. Dans le roman, elle est prononcée par le Dr Karl Abraham, à l'attention du psychanalyste Friedrich Pfister dont il est le superviseur : « Il me semble que vous cherchez à nier le temps qui passe et le caractère éphémère de l'existence dans votre quête de quelque chose d'impérissable. »(2)
J'avais poussé le vice jusqu'à recouvrir la tranche de la première et de la quatrième de couverture de tous mes livres d'une bande de ruban adhésif, justement pour prévenir tout accident, et renforcer la coque de ces navires miniatures qui me portaient sur toutes les mers de l'imagination. Comme le marin calfate son embarcation ou bien à la manière de ce grand sportif qui entoure d'un bandage sa main ou son pied déjà fragilisé et qu'il sait devoir protéger des assauts d'une épreuve à venir.
Mais à la longue, j'ai fini par remarquer que non seulement ces pansements n'évitaient pas les écornements mais que, lorsque ceux-ci survenaient malgré mon soin obsessionnel, la pliure, la plaie en était renforcée au plus profond de sa chair, au point d'en devenir comme une malformation congénitale. Puis le temps se chargea de souligner avec ironie mon idée saugrenue. Je constatai, à mon grand désespoir, qu'une fine pellicule de poussière venait s'agglomérer sur le bord externe du ruban adhésif, alors que je prenais soin de rendre celui-ci le plus transparent possible en le grattant avec mon ongle. Ainsi, tous mes efforts pour le protéger ne faisaient que pointer du doigt ma lubie excentrique et la rendre futile, dérisoire, inopérante. J'en vins tout naturellement à la conclusion que si je voulais qu'ils restent intacts, je n'avais d'autre choix que de retarder le moment de les lire, contemplant mes acquisitions et goûtant par anticipation leur saveur à proportion de leur jeunesse — autrement dit, plus un livre était neuf et plus le désir de le lire était grand, ce qui paradoxalement avait pour effet de retarder le moment de sa découverte. Et quand j'avais épuisé l'anticipation au point qu'elle ne me nourrisse plus assez, que l'envie de la découverte dépassait le risque encouru, je finissais par céder en prenant toutes les précautions du monde pour l'ouvrir.
Bien évidemment, ce moment impliquait une gestuelle précise et un environnement propre. Il me fallait le manier comme une relique et je n'écartais jamais à l'excès la tranche quand bien même l'ouvrage particulièrement rigide résistait à mon timide assaut. L'origine de ce trait de personnalité provenait d'un atavisme paternel qui ne se limitait pas uniquement aux livres, mais à bon nombre d'objets du quotidien allant de la vaisselle aux outils, en passant par la voiture ou les vêtements et gagnant même le lieu d'habitation tout entier. Pour autant, il ne me serait jamais venu à l'esprit de caractériser mon père ni mes aïeuls de “matérialistes”, loin de là. Ne rentrait dans ce respect, cette sollicitude des choses matérielles aucune considération tendancieuse ou déviante, aucune avarice, ni surévaluation par rapport aux choses spirituelles. Il s'agissait plutôt d'une nature, d'un comportement qui allait de soi pour eux, quelque chose d'inné dans cette façon d'user, de ranger, de nettoyer tout ce qu'ils touchaient ou tout ce qui peuplait leur monde. J'avais donc probablement hérité de cette façon soigneuse et attentionnée d'envelopper mes biens matériels, et ma mère, aux antipodes de ces conduites scrupuleuses, s'amusait de mon vice, sans jamais le railler, ni le dénigrer, mais plutôt en l'observant avec une certaine tendresse, en la détaillant comme les mœurs d'une culture opposée à la sienne.
 |
| ⓒ Le_lasseur. |
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré peu de personnes qui avaient cette même manie. La plupart considérait au contraire qu'il faisait partie de la vie du livre de subir les négligences de ses lecteurs, que c'était même la preuve qu'il avait porté ses fruits. Comble d'ironie, je trouvais beaux certains livres aux pages froissées, racornies, délavées, jaunies par l'âge, asséchées et cartonnées par le sel de mer ou les expositions trop prolongées au soleil, crissantes sous les grains de sable, grasses et fibreuses des atmosphères confinées, exhalant des odeurs de grenier, de vieilles malles, de parfums tenaces(1). Derrière ces témoignages sensoriels, il y avait plus que le livre. L'objet devenait un écrin mystérieux qui détenait une part de ses lecteurs et de leur vécu. Ce complément de vie qui prenait possession du livre et sur lequel l'auteur n'avait aucun pouvoir, me donnait l'impression d'entrer en contact avec un parent éloigné, par le hasard d'une envie commune de découvrir la même œuvre. Et comme si cela majorait la curiosité envers cette œuvre, une sorte d'impératif se joignait à mon désir et achevait de briser toutes les barrières qui jusque-là me retenaient d'ouvrir l'ouvrage.
Quand je parvenais enfin à terminer la lecture d'une de ces œuvres, elle retournait dans la bibliothèque, presque inaltérée, ou du moins sans qu'aucun des infimes stigmates de mes nombreuses, mais non moins délicates, manipulations puissent trahir ma lecture. Mais elle n'était pas à l'abri du danger pour autant. Si j'avais eu le malheur de me délecter du texte, je ne manquais pas d'en faire l'éloge auprès de mon entourage. Et sans prendre garde aux conséquences, je vantais avec force arguments les mérites du livre jusqu'à provoquer un désir irrépressible chez mon interlocuteur. Au moment où je l'entendais prononcer la phrase : “tu m'as donné envie de le lire !”, je ressentais la satisfaction de l'avoir convaincu, la joie du partage à venir et donc la nécessité impérieuse, le devoir de lui fournir sur le champ l'objet de notre échange. Si bien qu'au plaisir se mêlait quasi instantanément le regret du prêt inévitable, sans pouvoir maîtriser la peur qu'il ne me revienne en l'état.
Je prenais soin de le mettre en garde, sans trop en rajouter, et je faisais mes adieux au livre en mon for intérieur, bafouant presque l'enthousiasme avec lequel je lui avais vendu l'œuvre. Puis je cherchais à convertir mon regret en tentant de deviner si le plaisir qu'il allait en tirer méritait un tel sacrifice. Ou bien je me rassurais en me disant que s'il me revenait en mauvais état, ou même légèrement défraîchi — ce dont j'étais persuadé, à moins de le prêter à un ami aussi méticuleux que moi — ce serait l'occasion de le racheter neuf et de pouvoir prêter l'ancien sans plus me soucier de son état. Ou mieux encore, s'il avait eu un véritable coup de cœur, j'insistais pour lui offrir, arguant avec une douce hypocrisie que cela me faisait plaisir ou encore que j'avais trop de livres chez moi.
Alors, bien sûr, il était possible de gloser à souhait sur les raisons de ce soin exagéré, en supposant que le mimétisme générationnel ne soit pas une raison suffisante pour convertir tous les descendants : après tout mes sœurs n'étaient pas touchées par ce penchant monomaniaque, bien au contraire. Mais à travers mes nombreuses séances d'analyse thérapeutique, j'avais fini par déterminer un trait de caractère qui pouvait en être la cause : cette tendance à vouloir que rien ne bouge, que tout reste intact. Et en cherchant à comprendre les raisons de cette tendance, la première chose qui me venait se fixait inlassablement sur la peur de la mort. Que rien ne bouge pour protéger du temps qui dévore tout. Au hasard de mes lectures, je tombai sur cette phrase d'Irvin Yalom qui résumait mieux encore toute la problématique. Dans le roman, elle est prononcée par le Dr Karl Abraham, à l'attention du psychanalyste Friedrich Pfister dont il est le superviseur : « Il me semble que vous cherchez à nier le temps qui passe et le caractère éphémère de l'existence dans votre quête de quelque chose d'impérissable. »(2)
Évidemment, si je prenais le raccourci de dire que j'évitais de corner mes livres par peur de la mort, ça ne manquerait pas de faire sourire. Et pourtant, il y avait bel et bien un fond de vérité dans tout ça. Et ce fond de vérité refaisait surface à quelques très rares moments, quand je tombais sur l'un de ces livres hérités de ma toute première bibliothèque. Ses bandes adhésives sur les bords, sa couverture immaculée, sans rides, ses pages pressées les unes aux autres d'un bloc comme si le livre sortait tout droit de l'imprimerie, tous ces petits détails ont encore le pouvoir de me jeter trente ans en arrière. Et même si j'ai réussi à protéger mes premiers livres de cet ogre infatigable qu'est le temps, il vient subitement me pousser de derrière, comme une brusque bourrasque tentant de me déstabiliser du haut d'une falaise, et cherchant à briser net, par un vertige, ma contemplation d'un horizon infini.
(1) Ou encore « avec une étrange odeur de feuilles mortes » écrivait Jean-Paul Sartre dans Les mots, 1964, Folio Gallimard, p. 175.
(2) Le Problème Spinoza, Irvin Yalom, Le Livre de Poche, chap. XXVI, p. 350.
(1) Ou encore « avec une étrange odeur de feuilles mortes » écrivait Jean-Paul Sartre dans Les mots, 1964, Folio Gallimard, p. 175.
(2) Le Problème Spinoza, Irvin Yalom, Le Livre de Poche, chap. XXVI, p. 350.
 |
| ⓒ Camille Reposeur. Newcastle. |