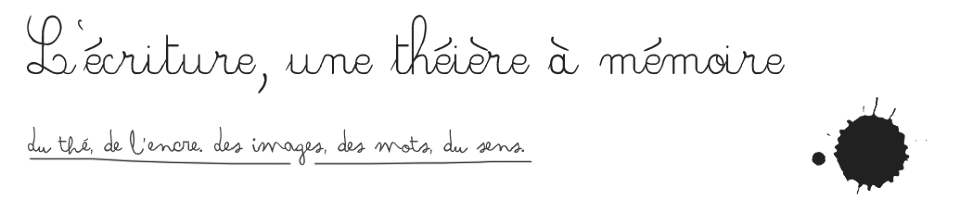Love. Texte et mise en scène de Alexander Zeldin.
Comme éventrée par notre curiosité, la salle principale d'un centre d'hébergement provisoire nous ouvre son espace froid et impersonnel. Les murs sont défraîchis, le mobilier usé et rudimentaire et hormis quelques modestes tableaux accrochés, l'atmosphère est peu chaleureuse, inhospitalière. Les lumières, encore tamisées, ne nous empêchent pas de distinguer de chaque côté de la scène, quelques sièges occupés. Ces témoins aux premières loges donnent l'impression d'attendre. Leur présence nous questionne sur leur rôle : sont-ils des comédiens qui simulent une salle d'attente ou des spectateurs, déposés là par une mise en scène cherchant à briser la ligne de démarcation entre public et comédiens ?
La pièce démarre lorsqu'une multitude de néons s'allument au plafond du centre d'hébergement, provoquant comme un léger sursaut à peine perceptible dans le public. Cette lumière blafarde et crue, identique aux éclairages des couloirs d'hôpitaux, des administrations, des parkings, des centres commerciaux, des lieux transitoires qui ne sont pas destinés à être habités, nous force à un réveil brutal, à une sortie de notre confort d'observateur distancié. Elle préfigure un quotidien dur, en lutte pour sa survie.
La routine journalière de huit résidents se met alors en place et leurs gestes apparemment anodins deviennent ici primordiaux au regard de l'exclusion qui les frappe. Ils ont une importance vitale. Ils témoignent du lien étroit qui les relie à une vie digne et décente. Dans la grande salle commune se croisent une soudanaise, un syrien, une famille avec un adolescent et sa sœur cadette et une vieille dame dépendante et son fils. Alors que l'exclusion qui les frappe devrait renforcer leur solidarité, l’exiguïté du lieu et la tension de leur précarité les poussent au contraire à s'éviter le plus possible. Et quand la confrontation est inévitable, elle génère des conflits ou de l'incompréhension. Chaque résident voit en effet la détresse de l'autre comme un miroir de sa propre détresse et cherche en conséquence à se convaincre que sa situation est meilleure que celle du voisin de chambre, que l'issue est proche et que le temps de l'attente se resserre.
Sauf que rien ne se passe. Le désœuvrement, l'attente s'étire et prend toute la place. Ce temps-là, les résidents ne cherchent pas à le combler
car il doit rester un temps vide, ouvert, qu'un avenir meilleur viendra
combler. Il demeure le temps de l'espérance. Et cet écoulement brut, silencieux et sourd, ne triche pas avec la mise en scène et vient briser
l'illusion du spectacle, du divertissement jusqu'à l'étourdissement : nous, spectateurs, finissons par attendre avec eux. Cette attente a quelque chose de pénible, elle dérange, provoque un léger malaise. Elle ressemble à un gouffre dans lequel n'importe qui peut être happé et montre notre impuissance, notre vulnérabilité.
Les résidents ne voient pas seulement dans l'autre un miroir de leur condition. Ce voisin est aussi un possible rival dans la quête d'un lieu de vie durable. Car l'injustice qui les frappe ne se contente pas de les exclure, elle pousse le vice jusqu'à les mettre en concurrence et briser l'entraide éventuelle. Et le peu d'informations qu'ils cherchent à glaner auprès d'une administration retranchée et impersonnelle les contraint encore à l'attente. Ils sont, en cela, les frères de route de Daniel Blake,
personnage principal du film de Ken Loach(1), prisonnier lui aussi de l'exclusion et des absurdes rouages administratifs ; compagnons de lutte aussi des personnages des frères Dardenne (cinéastes belges), attachés à dépeindre sans fard une société qui exclut, oppose et dépossède.
Alors que les pensionnaires du lieu sont confrontés au paradoxe de devoir investir un lieu qu'ils ne souhaitent pas habiter, qu'ils espèrent provisoire, la durabilité de leur condition et l'enfermement qui en découle les poussent dans leur retranchement. Comme s'ils avaient besoin de sortir d'une apnée, d'ouvrir des perspectives, les prétextes de sortie du centre sont autant d'occasion de reprendre espoir et contact avec l'extérieur, avec cette vie qui normalise. Pour ce faire, ils quittent la scène en franchissant le bord qui les sépare du public et la frontière entre comédiens et spectateurs devient à nouveau poreuse, comme avec ce public amarré au plateau.
Malgré tout, quelques infimes éclaircies viennent percer le ciel bas de ce paysage sans horizon. Des petites parcelles d'amour qu'il faut nettoyer des scories de désillusions, et extraire des rouages écrasants d'un quotidien monotone et incertain. Comme cet arbre qui se balance derrière la fenêtre, signe d'une nature immuable et sereine, source de vie. Ou cette possibilité de croiser un voisin qui parle la même langue, comme Tharwa et Adnan tous deux originaires de pays éloignés. Ou cette résilience que les enfants cherchent à travers le rap pour Jason ou le chant imprégné de spiritualité pour Paige, la plus jeune, dans lequel il est question d'étoile et de ciel brillant.
Mais la véritable et surprenante source d'amour qui convertit la détresse en espoir ne vient pas uniquement du plateau même si elle est provoquée par la mise en scène. Elle prend sa source dans le lien que les comédiens réussissent à tisser avec le public. Lorsque Barbara, la plus vieille des pensionnaires, décide de gravir les gradins de la salle avec peine, sans l'appui de sa canne, qu'elle risque à chaque marche de trébucher, elle lutte et puise au
fond d'elle-même la force de se dépasser et nous pousse, comme cette spectatrice, à lui tendre la main, brisant la barrière du
spectacle. Et même si je n'ai été témoin du miracle qu'une fois, je garde dans l'idée qu'il se produit à chaque représentation. Qu'il y a toujours, au milieu de la foule, un anonyme qui ose franchir le pas en faisant comme si tout cela était vrai, que la comédienne ne jouait plus, que la chute était possible. Et qui ose montrer au grand jour, sans peur du ridicule, que l'enjeu dépasse le jeu ; montrer que la compassion ne suffit pas, que l'action n'attend pas l'urgence.
(1) Moi, Daniel Blake, sorti en 2016. Palme d'or du festival de Cannes la même année.
 |
| Emma (Janet Etuk) ⓒ Nurith Wagner-Strauss. |