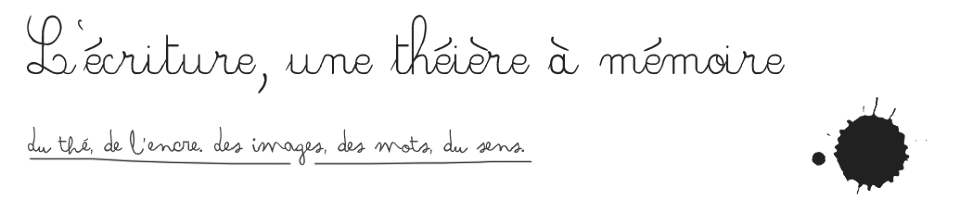Ernest ou comment l'oublier*
Là-haut, il y a Dieu. Sous Dieu, les étoiles. Et sous les étoiles, les artistes de cirque qui les décrochent et font le lien avec les hommes. En bas, il y a le plancher des vaches, celles que Marie-Louise trayait dans son enfance. Et sous le plancher des vaches, les morts. Marie-Louise et Yvonne, deux anciennes acrobates du cirque Ernesto, errent là, dans cet espace vibrant d'inanité, entre la terre ferme et la voûte céleste. Et dans un geste tendu par l'effort qu'elles arrachent à leur âge, elles tentent de combattre la pesanteur en grimpant sur leur armoire, les chaises, la table, pour ne pas sentir à leurs pieds, la froideur de cette terre et ses tubercules prêts à emprisonner leurs rêves.
Et tandis qu'elles montent, les étoiles devenues poussière d'or, se dérobent, tombent, et narguent leur souplesse défraîchie. Sitôt que Marie-Louise et Yvonne croient atteindre de nouveau le firmament, celui-ci se désagrège et recouvre leur logis, les contraignant au ménage, la plus ingrate des tâches quotidiennes. Poussière d'étoiles devient poussière de logis. Le firmament, plafonnier. Le cercle de la piste, encerclement. Les costumes, oripeaux, peaux de chagrin, grains de poussière...
« Rien ne se passe, personne ne vient, personne ne s'en va, c'est terrible. »** C'est terrible et en même temps, le fait d'attendre maintient la possibilité qu'il arrive, Ernest, et qu'il les invite à entrer de nouveau en piste. Dans l'attente, elles ouvrent péniblement un petit espace au destin. Seulement la destinée est bien trop grande pour se glisser dans le chas d'une aiguille. L'éventualité de reprendre, de recommencer le passé glorieux s'étiole. Alors, elles balayent la poussière. Et comme l'artiste ne meurt jamais, par la féérie de son art, le balai convoque le ballet. Un instant de distraction suffit à rallumer la flamme, aidé en cela par l'autre, qui porte aussi le même rêve, le même espoir.
Le passé est à la fois joie et terreur. Joie de leur éclat immortalisé sur le journal et terreur de leur jeunesse maussade. La difficulté ? Oublier le mauvais passé de peur qu'il ne revienne si Ernest ne revient pas. Chose impossible pour Marie-Louise qui doit composer avec une mémoire se noyant dans le puits insondable des souvenirs. Yvonne, alors seule gardienne du passé, s'en remet à Dieu et allume un cierge à défaut du cercle de lumière au centre de la piste.
La vie de Marie-Louise et Yvonne, figée dans la verticalité spatiale, l'est également dans l'horizontalité du temps qui passe. Le rituel devient alors une planche de salut en même temps qu'un piège. Il annihile le temps si bien qu'elles ne savent plus si le temps passe ou si ce sont elles qui passent sans lui. Elles ne sont jamais en accord avec lui, elles ne sont jamais dans le temps. Elles lui échappent en vivant dans leur armoire, à demi loge, à demi geôle, dans laquelle chacune des fenêtres est une lucarne ronde comme la lune, composant un regard ébahi de clown perpétuellement ouvert sur la prochaine venue d'Ernest.
Simone Veil écrit : « La monotonie est ce qu’il y a de plus beau ou de plus affreux. De plus beau si c’est un reflet de l’éternité, de plus affreux si c’est l’indice d’une perpétuité sans changement. Temps dépassé ou temps stérilisé. » La monotonie devient reflet de l'éternité lorsque le passé se fond dans le moment présent et que le coup de balai devient un numéro de cirque ; et indice de perpétuité sans changement lorsque la poussière revient et qu'il faut la nettoyer. Comme si l'éternité gagnée en étant vedette un jour, devait se payer pour l'éternité à souffler toutes les lumières allumées dans les yeux des spectateurs. Il ne reste plus qu'à se saouler pour tuer l'instant, ne plus avoir conscience et assouplir les corps sclérosés.
Lorsque le désespoir et la vanité de l'attente finissent par creuser une rage en elles, c'est qu'il est l'heure de se coucher, que le jour décline. Demain se répand déjà au sol, monte comme une vapeur, un faible brouillard au-dessus d'une froide rivière, et frôle l'armoire endormie. Il hante le logis et pourrait bien inviter l'écho. Pas question d'entendre le vide pour Marie-Louise et Yvonne. Éteignez les lumières. Le spectacle est terminé.
*Au Théâtre du Pont Neuf, du 31 avril 2015 au 04 mai 2015.
**Samuel Beckett, En attendant Godot.
 |
| Marlène Gagnol (à gauche) et Rachel Da Silva (à droite) ⓒ Marie-Yasmine Chemsseddoha. |