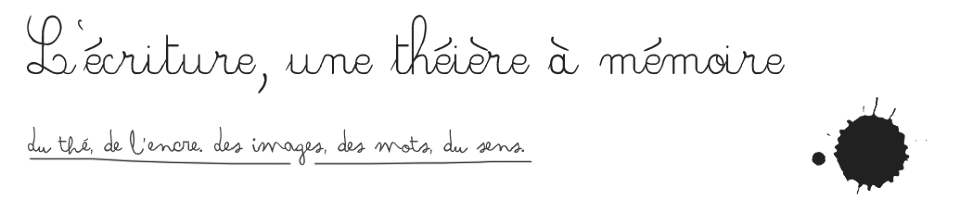Aron,
le poète de ma vie ! Aide-moi à desserrer l'étau de l'invisible qui nappe les
murs de ton bureau, délivre-moi de cette couche de suie des souvenirs qui
englue mes pensées ! Depuis le ciel de San Telmo que tu gouvernes, au cœur de
Buenos Aires, puisses-tu libérer mon esprit de cette vaine quête de sens qui
m'obsède jours et nuits.
Je suis
parfois saisie d’une puissante angoisse : elle me noue le ventre et me dit
que je ne pourrai plus quitter du regard cet escalier qui longe le mur décrépi,
et qui conduit à ce que j’imagine être un puits sourd, sans eau ni lumière, duquel
je guette une agitation soudaine, un reflet dansant, un son. Combien de fois je me suis répété l'enchaînement
des évènements tentant d'y trouver un sens caché, une constellation, une forêt
de lampadaires illuminés dans la nuit d’une ville même désertée. Mais rien.
Rien en dehors de ce tissage étroit d’événements aussi éloignés les uns des
autres qu'ils ont pris un malin plaisir à se frôler et s’entremêler. Alors, je
relis cet enchaînement, je me le chuchote un peu comme une prière, dans
l’espoir qu’un jour, cette litanie dise autre chose, et que les mots perdent
leur sens premier au profit d’une histoire tapie dans leur sonorité, ou que j’y
lise le dessein d’une quelconque divinité à laquelle je finirais par croire,
faute de mieux.
Lorsque
j’ai pu rassembler assez de force et de courage, le lendemain de ta mort, j’ai
poussé la porte de ton petit cabinet de travail et me suis assise à ton bureau.
Je tenais fébrilement ton dernier recueil de poèmes entre mes mains, ouvert sur
ton plus beau texte : Le chandelier.
Et je pleurais. Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Quand les larmes
menaçaient d'inonder mes paupières, et que j’étais incapable de lire, je relevais
la tête et posais mon regard sur le mur écaillé qui longe l'escalier extérieur.
Hors de question que ma peine puisse se répandre sur tes mots et faire gondoler
le papier de ton livre : je laisse le soin au temps de faire ses propres
ravages, puisque tout doit disparaître un jour ou l’autre.
D’abord
mêlés à mon sanglot, puis se distinguant nettement comme des hurlements de
jouets d’enfants, j’ai reconnu des sirènes de voitures de secours. J’ai cru que
tu venais à nouveau de mourir, c’est idiot ! Mais l’horloge indiquait
presque la même heure que la veille, peu de temps après ton départ pour
l’hôpital. J’ai pensé que l’ambulance venait te chercher, comme si tu n’étais
pas encore parti. Je me suis retourné machinalement pour voir si tu n’étais pas
allongé, haletant, sur la méridienne. Non, je n’ai pas cru que tu aies pu ressusciter,
mais plutôt que le temps jouait à rebours, un instant, et qu’il allait peut-être
m’offrir un mirage, une hallucination, quelques secondes seulement. La
méridienne vide, j’ai alors pensé que l’ambulance te ramenait et que le
personnel hospitalier essayait de me prévenir par les sirènes hurlantes. J’ai
refermé ton livre et l’ai laissé là, sur ton dernier carnet d’écriture inachevé.
Puis,
avant de quitter le bureau, j’ai entendu des gens appeler quelqu’un avec
insistance, en forçant la voix, et pénétrer avec fracas dans l’immeuble
d’à-côté. Les secours, probablement. Mon imagination m’a portée à croire que
j’étais victime d’une malédiction et que je ne devais plus m’introduire dans
ton bureau, si je voulais éviter que quelque chose de grave se produise à mes
côtés. Fort de cette superstition, je me suis fait la promesse de ne pas
remettre les pieds, avant quelques semaines, dans cet endroit qui t’appartenait
bien plus encore que de ton vivant, comme ton propre tombeau mais aussi le
tombeau de tes écrits.
Quelques
jours plus tard, j’ai reçu un coup de fil de l’hôpital. Une voix masculine,
posée et légèrement intimidée m’a interpellée :
«
Madame Balmer ?
–
Oui, c’est moi !
–
Bonjour Madame. Je suis Pablo Gomez de l’hôpital Général Niños Pedro de Elizalde,
le médecin urgentiste qui est…
–
Oui, bonjour Monsieur !
– Je
suis absolument désolé de vous importuner mais je voudrais savoir si vous
n’auriez pas retrouvé une petite carte avec une photo, comme une carte
d’identité, vous voyez, avec une croix rouge ?
Sa
voix a refait surface, ses appels répétés pour te garder alerte, pour atténuer
la panique qui me gagnait, ses recommandations, ses directives. Une seconde,
j’ai revu clairement ton visage blême, tes yeux qui disaient au revoir. J’ai
oublié sa question qui a fini par se perdre parmi les images de cette journée
qui défilaient en désordre, lorsqu’il a prononcé de nouveau mon nom.
–
Madame Balmer ?
–
Non, ça ne me dit rien. Je regrette. Attendez…
Je
ne voulais pas le décevoir, je revoyais son acharnement à te maintenir en vie, ses
gestes précis, sa main sur mon bras, je pensais qu’il était un homme bon. Et
puis j’avais une opportunité de pouvoir revenir dans ton bureau, de briser cette
sotte idée de superstition en étant accompagnée, secondée, même à distance et
sans qu’il le sache.
– Ne
quittez pas, je vais voir un peu plus loin. »
Je
suis entré dans ton bureau et l’odeur rance des tulipes rouges fanées m’a piquée
au nez. Quelques pétales épars couvraient tes carnets et ton livre. J’ai fouillé
rapidement la pièce du regard, sans conviction, mais tout était en ordre. Rien
non plus sous ton bureau, sous la méridienne. J’en ai informé l’urgentiste puis il
m’a saluée, s’excusant une nouvelle fois pour le dérangement.
J’ai
écouté le silence qui a suivi. Je l’ai accueilli. Le temps que j’embrasse du
regard la pièce sans contrainte, ma respiration s’est ralentie, et un son est
venu interrompre cette communion avec ton lieu à toi : j’ai entendu des pas foulés en rythme le ciment, dehors. Derrière le rideau de la fenêtre qui fait face à ton bureau,
j’ai aperçu un homme qui descendait les escaliers. Il portait un long morceau
de bois tressé enroulé sur lui-même. Puis il a remonté les marches, pour
redescendre avec d’autres objets. J’ai compris qu’il débarrassait la terrasse de
l’immeuble d’à-côté. Dans les bras de cet inconnu, tout un passé à l’abandon, usé,
parfois rouillé, ou simplement recouvert d'une fine poussière, de moisissures, quittait
l’énigmatique hauteur de ce bâtiment voisin : des chaises, des pots en
terre, des outils, des restes d’un carrelage noir et blanc aux formes
géométriques, des pinceaux…
Au
bout de quelques minutes, je ne l’ai plus vu. Je ne savais pas s’il s’était
éclipsé par une autre sortie de la terrasse ou fouillait encore le toit. Dans
cet intervalle, le souvenir du bruit assourdissant de la sirène est revenu électriser
ma mémoire et j’ai pensé que notre voisin était mort, que sa famille venait
débarrasser ses affaires tandis que moi, je vivais parmi les tiennes. Ma
superstition n’était peut-être pas si éloignée de la vérité. Le poids de cette pensée
et celui de ma solitude ont commencé à peser sur ma poitrine, et mes jambes n’ont
plus pu me soutenir. Je me suis assise à ton bureau et j’ai éprouvé le besoin
de te sentir près de moi. J’ai pensé que, peut-être, ton âme avait fait une
escale sur la terrasse, juste au-dessus, juste à côté, tout près de l’âme de ce
voisin que nous ne connaissions pas et qui lui aussi portait un nom allemand.
Je vous imaginais, je voyais vos corps translucides flotter là-haut, tandis que
l’homme de l’escalier vous faisait de la place dont vous n’aviez pas besoin,
tout deux absorbés par la discussion centrée sur votre passé commun de juifs
fuyant le nazisme. Car cette idée t’avait traversé l’esprit : tu avais
imaginé que notre voisin pouvait être un de tes anciens camarades de classe, ou
plus simplement, un habitant du Spandauer Vorstadt – le quartier de ta
jeunesse, à Berlin – et que la fuite d’une menace commune, agrémentée d’une pointe
de malice du destin, aurait déposé là, à Buenos Aires, dans le quartier de San
Telmo, pour être voisins une seconde fois, à l’autre bout du monde.
Alors
que s’immisçait en moi, par le biais de ces divagations, une timide
réconciliation avec le lieu sacré de ton travail, je finis par oublier l’homme
de l’escalier, à tel point que lorsqu’il descendit lors d’un de ses nombreux
allers-retours, il brisa ma rêverie comme un fantôme déposé là pour me ramener
à la réalité. Il tenait dans le cercle de ses bras tendus en avant, une statue,
qu’il semblait secourir. Bien qu’elle me tourna le dos, sa longue robe blanche
qui lui masquait les pieds, sur laquelle plissait un chasuble bleu qui lui
faisait comme un ciel à porter toute une sainte éternité, et ses quelques
boucles brunes qui lui encerclaient la nuque ont fini par me convaincre qu’il
s’agissait du Christ. L’homme de l’escalier portait le Christ. J’en eus la
confirmation par un autre détail : au-dessus de sa tête, comme s’il lui
sortait du crâne pour peu que j’en oublie la perspective, un chandelier l’auréolait.
Oui, Aron ! Le chandelier de la terrasse du voisin. Celui qui dépassait du
mur, tout là-haut, sur la terrasse. Ton
chandelier. Je peux dire qu’il t’appartenait sans faire offense à notre
voisin ni lui usurper son bien : il faisait partie de ta nouvelle vie, de
ta visée, de ton travail d’écriture, de ta poésie tout entière.
À
ton retour des geôles de la dictature du chef militaire Roberto Eduardo Viola,
ton esprit et ton corps exsangues n’ont pas entamé une foudroyante et vertigineuse
volonté de vivre et de dire les choses, sans pour autant savoir comment les
dire. Ni par où commencer. Et devant toi, derrière ta fenêtre, lorsque tu
levais les yeux de ta page blanche, il n’y avait que ce mur pour réponse. Tu avais
quitté le silence et le joug d’un mur pour faire face à un autre. Alors, tu as
levé les yeux encore un peu plus haut et tu as vu dépasser du petit muret de la
terrasse, ce chandelier à trois branches et cinq coupelles. Tout s’est
enclenché là, ou plutôt, tout a recommencé là, par cet objet anonyme qui semblait
sortir du mur comme je le vois désormais sortir de la tête du Christ. Car il
fallait que tu écrives à nouveau. C’était bien la raison pour laquelle tu avais
été arrêté : tout écrivain qui n’était pas en contact étroit avec l’État devenait
suspect. Tu affirmais que rien d’autre ne comptait que l’écriture et que les
tortures que tu avais endurées venaient entériner cette raison de vivre : en
effet, les souffrances inscrites dans ta chair étaient un appel à les inscrire
sur le papier cette fois. Il fallait, selon toi, que tu aies souffert pour une
raison : cette raison-là devenait ta raison de vivre. C’était un
chandelier mais ça aurait pu tout aussi bien être une échelle, une plante ou
tout autre chose encore, car rien n’aurait entamé cette volonté tenace de lever
le voile, et tout pouvait t’y conduire : il te suffisait de trouver la
porte d’entrée et elle était en toi. Bien évidemment, tu n’aurais pas pu
imaginer que sous ce chandelier trônait un Christ en plâtre. Et pourtant, tu
l’as deviné, à travers tes écrits.
Ce
chandelier te rappelait la menorah de tes parents, ton chandelier juif à toi.
L’objet qui disait tout de ta vie d'enfant à Berlin. Tu as longtemps regretté d’être
parti si tôt, loin de tes parents. Tu étais convaincu de les avoir abandonnés
alors qu’eux-mêmes t’ont poussé à te protéger, et partir loin. Puis, des années
après la guerre, n’ayant plus de nouvelles d’eux, persuadé qu’ils avaient été
déportés, tu regrettais cette fois de n’avoir pas emporté le chandelier que tes
parents t’avaient demandé de prendre avec toi dans tes bagages. Tu leur avais
affirmé qu’ils en auraient plus besoin que toi. Ce chandelier-là agglomérait désormais
dans ta mémoire tous les objets de ta vie à Berlin, et par contamination, toute
ta famille, toute ton enfance, tout ton passé, toute ta foi.
Et
tu te demandais pourquoi il n'y avait personne pour allumer ce chandelier
égaré sur la terrasse voisine. Combien de fois tu as voulu monter ces escaliers
pour y allumer ce ciel qui ne nous appartenait pas, chez notre
voisin que nous ne connaissions pas ! Si aucune lumière, aucun cierge ne
venaient éclairer cette terrasse c’était, selon toi, que plus personne n’était
là pour transmettre la foi parce que l’Église s’est rendue complice des plus
abominables crimes. Par ton poème intitulé Le chandelier, tu voulais dénoncer la collusion de l'Église et des puissants
criminels, des bourreaux qui nous gouvernent. Je t’ai défendu de l’écrire. Je
voulais que tu vives, je ne voulais pas risquer de te perdre. Et puis la
dictature est tombée, presque renversée par le chandelier, celui avec lequel tu as éclairé le monde. C’était comme
si tu avais vraiment gravi ces marches, là, dehors, que tu y aies allumé cinq
bougies et que la terrasse se soit illuminée. Puis que d’autres t’aient imité,
et que toutes les terrasses de San Telmo, de Buenos Aires et du pays tout
entier se soient illuminées. Que le peuple comprit enfin de quoi il retournait
et qu’il fasse tomber la dictature.
Pourquoi
est-il si difficile de montrer à quel point les poètes voient les choses que
nous ne voyons pas de suite ou que nous ne verrons probablement jamais ?
Il faudrait une vie entière pour raconter ce qui peut s’approcher d’une petite parcelle
de vérité condensée dans un poème. Et si seulement un homme était assez fou
pour y sacrifier sa vie, et que son labeur se fut achevé la veille de sa mort,
dans un chuchotement hésitant entre la plainte et la révélation, prononcé par
une voix éraillée à force de fatigue, il se serait tellement éloigné de son but
premier par tant et tant de digressions que même son histoire ne convaincrait
personne. Seuls les mots du poète peuvent nous seconder dans la lourde tâche de
déchiffrage du réel. Aron ! Tu ne savais pas ce qu’il y avait sous ce
chandelier et pourtant tu as tout deviné. Plus encore.
Non,
tu n’étais pas là pour voir la descente du Christ bleu ! Combien j’aurais aimé
que tu écrives un poème sur cet événement qui n’en était pas un ! Nous
avons vécu plus de quarante ans ensemble, Aron ! Et malgré toutes ces années,
malgré cette proximité silencieuse et taillée dans deux continents, je suis incapable
de savoir comment tu aurais réagi à la vue de cette statue.
Un
chandelier à trois branches, trois comme la trinité. Comme toi, j’ai toujours
refusé de croire au Dieu des églises. Comme toi, j’ai cru qu’il était possible
de revernir la foi, d’absoudre ce Dieu-là et de l’appeler autrement. Alors, j’ai
pensé que, peut-être, le meilleur chemin ou la meilleure porte pour communiquer
avec toi se trouvait dans une église, précisément là où tu ne voulais pas aller
tant que, disais-tu, ta mission n’était pas accomplie. Mais depuis, j’ai vu la
descente du Christ, j’ai deviné quelque chose. Le Christ a quitté les cieux de
la terrasse pour parler aux hommes. Est-ce toi qui l’en a chassé ? L’as-tu
délogé afin qu’il œuvre sur la Terre à nouveau ? N’aurais-tu pas accompli une
autre part de ta mission par ce biais ? Ou ta mission ne s’est-elle pas
achevée par ton départ ?
Je me
suis donc rendue à l'église de notre quartier, à San Pedro Telmo. J'y suis allée pour te lire une lettre, un matin. Pour te raconter la descente du Christ, pour
te raconter la seconde véritable histoire du chandelier de la terrasse. Je voulais
la lire à la Vierge et j’imaginais que mes paroles, même chuchotées, seraient
portées par elle jusqu’à son fils, et de lui jusqu’à toi.
J’ai
franchi le porche de San Pedro Telmo, et un soupir de l’église, matérialisé par
une bouffée d’air frais associée à l’écho de la pierre, m’a accueillie. J'ai
fait un signe de croix, quelques pas et me suis arrêtée pour observer la nef. Un
frisson m’a recouvert le corps. J’ai refusé de l’attribuer à la beauté du lieu,
ou à la dimension spirituelle qui aurait pu me saisir et déraciner mes méfiances.
J’ai résisté.
J’ai
marché, emportée dans mon élan par ce besoin irrépressible de te parler enfin, jusqu’à la première rangée de chaises, et persuadée que cette fois tu m’entendrais. Ainsi, installée tout devant, face à la Vierge enchâssée dans son
mausolée de bois verni, j’ai senti qu'elle me porterait comme elle portait son
enfant, et qu'elle me donnerait du courage pour te la lire. Il y avait quelques
fidèles présents, dont certains penchés sur leur prière. Personne ne
remarquerait ma lecture si je faisais comme si c’était une prière. J'ai levé la
tête pour regarder une dernière fois la Vierge, dans les yeux, avant de me
lancer, et c’est alors qu’un chuchotement, sur ma gauche, m’a stoppée net. J'ai
tourné la tête comme pour m’assurer que les personnes à l’origine de ce timide
échange ne s’approcheraient pas trop près, et je l'ai vue, là, devant eux :
la statue bleue du Christ. Le Christ de la terrasse. Je suis restée interdite. Je
l’ai vu de face cette fois, qui tenait dans ses mains le chandelier, lequel se
terminait par cinq petites coupelles contenant cette fois cinq bougies allumées.
Il n’y avait aucun doute, c’était bien le Christ que j’avais vu dans les bras
de cet inconnu descendant la rampe d’escalier, le long du mur de notre voisin, quelques semaines auparavant. Rien ne pouvait l’étayer de façon certaine,
bien au contraire : ici, dans cette église, par l’éclairage des bougies et
sa présence incarnée, il me semblait qu’il avait plus d’éclat, de charisme, qu’il
était plus grand et qu’il pût se passer du secours des hommes, au contraire du
Christ de la terrasse. Et pourtant, j’acquis la ferme conviction qu’il
s’agissait du même, que c’était lui. Le couple de touristes, ceux qui m’avait détournée de ma lecture, le prenaient en photo, et semblaient lui
confier quelques secrets, formant ainsi, tous trois, un petit groupe que je
jalousai. Je fis grincer ma chaise autant pour les distraire de ce conciliabule
que pour qu’ils s’écartent et offrent à ma vue la statue dans sa totale
splendeur et que pas une parcelle de son corps ne manquât à nos retrouvailles. Et
je compris que c’était toi, Aron, qui avais quelque chose à me dire, ici, dans
le cœur de cette église. Je ne savais pas encore quoi exactement. Il y avait
quelque chose que je ne maîtrisais pas pleinement. Je repliai aussitôt ma
lettre qui me parut désormais pleine de vacuité et je regagnai le parvis
brûlant de San Pedro Telmo.
Le
soleil, en train de fondre sur le toit du bâtiment d’en face, vint brûler mes
derniers frissons, témoins cette fois de ma surprenante et émouvante découverte.
Je résolus de revenir à l’appartement à pas lents, prenant même un chemin
légèrement plus long qui m'eût permis de méditer. À un croisement, sur le
trottoir, j’aperçus un petit homme âgé assis derrière une carriole pleine de
fleurs. Coincées entre les iris et les lys, je remarquai quelques tulipes
rouges, tes fleurs préférées. Je lui adressai un sourire et lui demandai de me préparer les tulipes
restantes. Il saisit délicatement les huit dernières, comme si chacune était
unique et qu’il devait leur adresser un message d’adieu, puis saisit le coin d’une
feuille de journal au-dessus d’une pile, sur sa gauche. Il enroula mes tulipes
dans la feuille de journal et me demanda trente pesos que je lui tendis avec le
même sourire qu’à mon arrivée.
De
retour à l’appartement, je n’ai pas ressenti de douleur ni de difficulté à
pousser la porte de ton bureau : j’avais en tête l’idée de remettre un peu
de vie dans ce lieu lugubre, aidé en cela par la réhabilitation du Christ dont
je venais d’être témoin. Sur ton bureau trônait le vase vert translucide en
forme de goutte d’eau qui répandait sa lumière émeraude sur tes crayons. Je
déroulai la feuille de journal, libérant les tiges de leur gaine de papier
imprimé et les déposai une à une, dans le vase, les comptant comme si tu étais
là, à côté, et que tu ne puisses plus voir. Ma tâche terminée, je m’apprêtai à
jeter le papier lorsque j’aperçus au centre de la page consacrée à la politique
intérieure, la photographie de l’entrée de notre immeuble, rue Carlos Calvo, le
370. Plus précisément, le cadrage était focalisé sur le 372, l’immeuble de
notre voisin, celui au nom allemand, celui que nous ne connaissions pas. Puis
j’ai lu la légende de la photo, presque amusée, intriguée d’y lire un secret,
peut-être même une référence à un épisode de notre vie. Mon sang se glaça, et
les mots, après les avoir lus, ont presque instantanément perdu leur
signification. Ne subsistait que la douleur, comme si les tissus de mon cœur se
tordaient dans la pression que le fer rougeoyant de l’horreur s’acharnait à exercer méticuleusement. Je fus
contraint de relire la phrase deux fois avant de pouvoir prendre véritablement
conscience de l’implication pleine et entière de leur portée à l’échelle de notre vie. La légende de la photo indiquait : Le
372 de la rue Carlos Calvo, résidence de l’un des bourreaux des prisons de la
dictature argentine. Puis j’ai lu le titre de l’article : Arrestation d’un ancien nazi surnommé
« Otto ». Il y avait, à côté de la photo de nos entrées
d’immeuble, en vignette, l’image d’un homme chétif, âgé, presque dégarni, dont
le regard fusillait le photographe en même temps qu’il exprimait un certain
détachement. Un regard qui n’appartient qu’aux coupables des pires fautes. Ce coupable-là vivait
là, tout contre nous. Il était notre voisin, celui que nous n’avions jamais vu. Celui
que tu voulais rencontrer, Aron.
J’ai
perdu l’instinct de ma propre respiration comme si je m'apprêtais à naître une
seconde fois et que mon corps cherchait à se souvenir comment il devait se mettre
en marche. Ou comme si je sortais indemne d’une noyade et qu’il n’y eut aucune
eau autour de moi. Tout s’est mélangé dans ma tête : le chandelier, le
Christ, le mur décrépi, le voisin au nom allemand, la terrasse, les tulipes,
les sirènes le lendemain de ta mort. Oui, j’ai cru que notre voisin était mort,
lui aussi, mais les sirènes ne venaient pas de voiture de secours, mais de
voitures de police. Ils venaient l’arrêter. Plus tard, ils sont venus
débarrasser sa maison. Qui ? Je l’ignore.
Puis
ce ne fût plus seulement les détails récents que je vins à questionner mais toute
notre vie. Pourquoi fuir le nazisme et non lui résister ? Pourquoi
avions-nous choisi l’Argentine ? Pourquoi étions-nous venus nous installer
ici, dans cette rue et pas une autre. Je t’avais fait remarqué qu’habiter dans une
rue qui porte le nom d’un juriste et diplomate était de bon augure. Tu m’avais
répondu quelque chose de cette teneur : « Les signes ne signifient rien en dehors de ceux qui les
pensent et en usent pour leur propre compte. » Et en effet, les bourreaux
pensent se mettre à l’abri en usant des mêmes présages. Otto avait sans doute pensé la même chose que moi.
Lorsque
les images qui se bousculaient en cascade ont fini par reprendre leur place,
j’ai lu l’article au complet. Il y était question notamment de l’École
Supérieure de Mécanique de la Marine, le plus grand centre de détention et de
torture du régime, dans lequel tu avais passé trois années. C’était là, et dans
d’autres centres de détention, qu’Otto et d’autres nazis avaient importé des
techniques de torture expérimentées en Allemagne. L'ombre de la cruauté n'a pas besoin de soleil pour se répandre. Elle n'a ni visage, ni nom, car elle ne suit personne. Elle n'a pas non plus besoin d'espace car en tous lieux, comme le chiendent, elle se faufile et nous empoisonne en prenant tout son temps. Elle
nous côtoie parfois toute une vie et il suffit d'un tout petit concours de
circonstances pour qu'elle surgisse au grand jour et entaille notre chair de sa lame
tranchante. Je ne saurai jamais si ce bourreau était aussi le tien. Je me
souviens de ce que tu m’avais dit des tortionnaires : certains avaient
l’accent allemand. Si ce chandelier, là-haut, n’était pas allumé c’était bien
pour une raison. Et tu t’étais acharné à la deviner. Aron, tu ne savais pas
qu’il y avait un Christ sous le chandelier et tu ne savais pas non plus que ce
Christ appartenait à un nazi. Mais tout est dit dans ton poème, tout est clair.
Aron, je suis assise à ton bureau. Je ne
pleure plus. Ton recueil de poèmes est là, je l'époussette et le remets à sa
place dans ta bibliothèque. Dehors, le soleil se répand par intermittence sur
le mur décrépi, gêné dans sa tâche par un ciel maculé de petits nuages au
contour net et plissé, qui jouent les obturateurs d'une journée paisible. Je referme la porte
de ton bureau. La couche de suie des souvenirs se délite, à l’image de ce crépi
dans lequel tu y puisais aussi ton inspiration. Un jour, tu l’avais baptisé
« ton marc de crépi ». Les jours qu’ils me restent à vivre sans toi,
je sais désormais que je vais les consacrer à chercher le mien, « mon marc
de crépi ». Puis quand je l’aurai trouvé, j’attendrai que la vie même lui
donne raison ou tort.