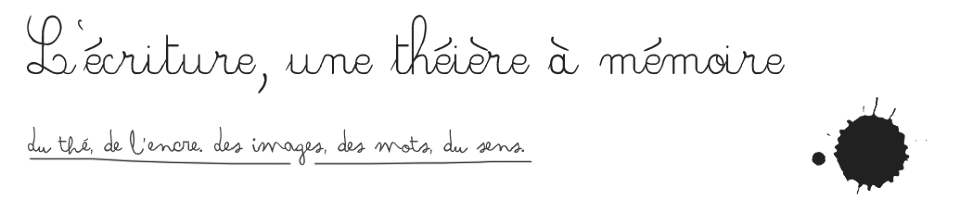Toute mort est Deus ex machina, un coup du sort, tabou et péremptoire, qui renverse tout. Ou, pour le dire autrement, la mort est la plus grande et la plus innomable surprise que l'existence nous réserve. Elle nous est garantie dès que la vie nous anime, mais sans jamais nous préciser son heure. Le tragique dans tout ça, c'est qu'elle nous est donnée et retirée aussitôt, offerte privée de toute conscience. Sans compter qu'elle se paye le luxe d'accabler nos proches qui pleurent la surprise manquée offerte au défunt.
La mort, notre Deus ex machina. Si l'on veut bien excepter les résonances religieuses tout autant que les pensées obsédantes qui nous poussent à deviner ce qu'elle précède, la mort est bien une délivrance. N'est-ce pas le propre du Deus ex machina, de nous sortir d'un embrouillamini sans nom duquel il faut sans cesse extraire un pied noyé dans la boue noueuse du présent, avant de devoir reposer son jumeau, sentant que l'équilibre nous y oblige, au même titre que Sisyphe qui ne cesse de pousser son rocher d'un flanc de colline à l'autre, sans quoi son fardeau, sa raison de vivre l'écraserait lui, dans un moment de relâchement et d'inattention. Une délivrance face à cet incessant enchevêtrement de possibles qu'il faut dénouer à chaque respiration alors que la mort nous coupe le souffle, pareil à cette poussière de souffre que l'on aspire sans la voir et qui se loge derrière la glotte, faisant mine de saper notre joie à contempler l'étincelle née l'instant d'avant, sauf que son petit nuage ne fait pas le poids face aux litres d'air qui s'apprêtent à le dévorer.
Et si la mort se désespère de trouver une faille anachronique — parce que son heure n'est jamais la nôtre — dans notre quotidien, voilà qu'elle baisse les bras et se retranche derrière le vieillissement du corps ou des fractures assignées à certaines parties de celui-ci. Le plus triste n'est pas tant de souffrir, dans ce cas-là, que de devoir sentir que la surprise approche et perd ainsi de sa superbe, réduisant en poussière le zèle constant d'une vie à relayer son attente, autant que le désir de lui donner un visage. Si la mort triche, il y a de quoi déprimer et il devient légitime de tricher aussi et de lui voler son pouvoir, de la surprendre.
La mort, notre Deus ex machina. Si l'on veut bien excepter les résonances religieuses tout autant que les pensées obsédantes qui nous poussent à deviner ce qu'elle précède, la mort est bien une délivrance. N'est-ce pas le propre du Deus ex machina, de nous sortir d'un embrouillamini sans nom duquel il faut sans cesse extraire un pied noyé dans la boue noueuse du présent, avant de devoir reposer son jumeau, sentant que l'équilibre nous y oblige, au même titre que Sisyphe qui ne cesse de pousser son rocher d'un flanc de colline à l'autre, sans quoi son fardeau, sa raison de vivre l'écraserait lui, dans un moment de relâchement et d'inattention. Une délivrance face à cet incessant enchevêtrement de possibles qu'il faut dénouer à chaque respiration alors que la mort nous coupe le souffle, pareil à cette poussière de souffre que l'on aspire sans la voir et qui se loge derrière la glotte, faisant mine de saper notre joie à contempler l'étincelle née l'instant d'avant, sauf que son petit nuage ne fait pas le poids face aux litres d'air qui s'apprêtent à le dévorer.
Et si la mort se désespère de trouver une faille anachronique — parce que son heure n'est jamais la nôtre — dans notre quotidien, voilà qu'elle baisse les bras et se retranche derrière le vieillissement du corps ou des fractures assignées à certaines parties de celui-ci. Le plus triste n'est pas tant de souffrir, dans ce cas-là, que de devoir sentir que la surprise approche et perd ainsi de sa superbe, réduisant en poussière le zèle constant d'une vie à relayer son attente, autant que le désir de lui donner un visage. Si la mort triche, il y a de quoi déprimer et il devient légitime de tricher aussi et de lui voler son pouvoir, de la surprendre.
« Tout est accompli. Désormais je n'appartiens
Plus aux mortels. Ô consommation de mon temps !
Ô Esprit, toi qui nous a nourris, toi qui règnes
En secret au plein du jour et dans la nuée,
Et toi, ô lumière, et toi la Terre, ô ma Mère !
Me voici, serein, puisque mon heure m'attend... »
Le suicidé ne gagne sa sérénité qu'en sacrifiant la volupté de chaque instant qui retient la possibilité de la mort, certes, mais une volupté qui se gonfle du nectar des instants d'avant son surgissement et nourrit notre sève d'atomes séraphiques. L'instant soufflé, s'abat alors une pluie d'épées, retenue dans le ciel bas de notre condition terrestre. Elle déchire cette promesse tâtonnante dans un désespoir soudain qui l'entraîne loin de l'envol mais la fossilise en souvenir : l'ombre de la mort surgit et interrompt cette volupté, avant d'être évincée à son tour par le souvenir retenant les exquis succédanés de vie qui s'enchaînent. Au même titre qu'un funambule risque à chaque pas de sombrer, y compris lorsqu'il n'avance plus, pour nous qui ne sommes pas funambules, l'instant remplace le pas. Et il ne nous viendrait pas à l'esprit de retenir l'instant ni même de conserver la volupté à son apogée, comme au funambule de garder l'équilibre sans avancer puisqu'il le défie précisément dans le mouvement. Le défi est dans le pas de plus, dans le piétinement de la mort.
Lorsque la mort nous emporte, l'âme s'envole. La psyché devient plus légère que l'air, libérée de la pesanteur de la peur, des racines de la douleur. Pysché, justement. Abandonnée au sommet d'une colline à son funeste destin, celui que lui avait prédit la Pythie et auquel son père se résigna, est promise à un monstrueux serpent volant puisqu'aucun homme ne se sent digne d'épouser une femme à la beauté surnaturelle. Elle sait désormais qu'elle va mourir. Elle attend son heure. De divinité, elle devient humaine, et guette la fin de ses tourments lorsque le Deus ex machina s'annonce dans un frottement d'ailes. Ce ne sont pas les ailes de ce monstrueux serpent, mais celles de Zéphyr qui viennent l'emporter loin de sa fin attendue. Ici, Psyché tombe dans la volupté de la mort, laquelle vient la délivrer de la vie tout en la maintenant en vie. Psyché se sent vivante à sa mort. Et si elle vit sa mort, c'est bien la preuve qu'elle est divinité. Sa main gauche, perdue entre abandon et douce crispation, donne la mesure de cet envol en conscience vers l'état de grâce. Alors qu'aucun humain ne voulait l'épouser, elle se persuada n'avoir aucun corps, n'être qu'une âme. À travers l'expérience de cette mort, elle sent son corps porté, son poids et se convainc de son existence. Dans le soulèvement, dans la lévitation de son corps, paradoxalement elle sent cette condition terrestre qui lui fait défaut.
Libérée de cet espace clos, et déjà sombre, ouvert et fermé à la fois comme le nid d'un tombeau à venir, elle s'envole vers un ciel clément, le bleu de l'horizon déraciné et transporté dans les cieux, alors que les noirs nuages prennent racine derrière son ombre, à peine au-dessus du sol. Si ce Deus ex machina, qu'incarne Zéphyr, n'est pas une mort c'est parce que Psyché n'est pas humaine. Elle reste et demeure une divinité. Zéphyr lui rend son statut.
Plus tard, elle donnera à Éros une fille qui portera le nom de volupté, Édoné. Hommage et témoignage pour dire la béatitude de ressentir la mort dans chaque instant, et comment chaque transport recueille en son sein, la poursuite ou la fin de la vie.
Lorsque la mort nous emporte, l'âme s'envole. La psyché devient plus légère que l'air, libérée de la pesanteur de la peur, des racines de la douleur. Pysché, justement. Abandonnée au sommet d'une colline à son funeste destin, celui que lui avait prédit la Pythie et auquel son père se résigna, est promise à un monstrueux serpent volant puisqu'aucun homme ne se sent digne d'épouser une femme à la beauté surnaturelle. Elle sait désormais qu'elle va mourir. Elle attend son heure. De divinité, elle devient humaine, et guette la fin de ses tourments lorsque le Deus ex machina s'annonce dans un frottement d'ailes. Ce ne sont pas les ailes de ce monstrueux serpent, mais celles de Zéphyr qui viennent l'emporter loin de sa fin attendue. Ici, Psyché tombe dans la volupté de la mort, laquelle vient la délivrer de la vie tout en la maintenant en vie. Psyché se sent vivante à sa mort. Et si elle vit sa mort, c'est bien la preuve qu'elle est divinité. Sa main gauche, perdue entre abandon et douce crispation, donne la mesure de cet envol en conscience vers l'état de grâce. Alors qu'aucun humain ne voulait l'épouser, elle se persuada n'avoir aucun corps, n'être qu'une âme. À travers l'expérience de cette mort, elle sent son corps porté, son poids et se convainc de son existence. Dans le soulèvement, dans la lévitation de son corps, paradoxalement elle sent cette condition terrestre qui lui fait défaut.
Libérée de cet espace clos, et déjà sombre, ouvert et fermé à la fois comme le nid d'un tombeau à venir, elle s'envole vers un ciel clément, le bleu de l'horizon déraciné et transporté dans les cieux, alors que les noirs nuages prennent racine derrière son ombre, à peine au-dessus du sol. Si ce Deus ex machina, qu'incarne Zéphyr, n'est pas une mort c'est parce que Psyché n'est pas humaine. Elle reste et demeure une divinité. Zéphyr lui rend son statut.
Plus tard, elle donnera à Éros une fille qui portera le nom de volupté, Édoné. Hommage et témoignage pour dire la béatitude de ressentir la mort dans chaque instant, et comment chaque transport recueille en son sein, la poursuite ou la fin de la vie.
 |
| Pierre-Paul Prud'hon, L'Enlèvement de Psyché, 1808 ⓒ Musée du Louvre. |