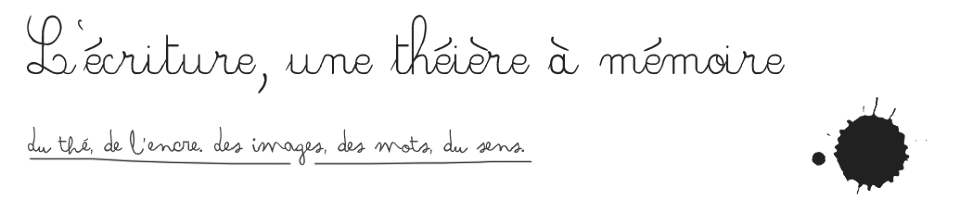Un long rideau de steppes glisse sur les traverses de mes paupières et dans ses plis se loge la plainte d'un homme, Vladislav. Elle dit sa peine qu'un horizon se ferme, sa toute naissante nostalgie de ce passé en même temps que la joie qu'il soit en lui pour toujours. Le théâtre de l'instant clôt la beauté de la souffrance du cœur. Elle a maintenant une musique et lorsqu'elle se répand, cette rivière nous porte dans la langeur et la consumation d'un temps infini. Cette musique est un élément naturel, tantôt eau, tantôt végétale. Une rose dans un vase, égarée. Et ses épines sont encore vives bien qu'elle se fane à mesure que les souvenirs forment des synapses. Elle a vécu et elle va vivre encore.
Des notes aiguës comme des petites offrandes en chapelets qui me glissent entre les doigts, et je les regarde tomber, lentement, presque en apesanteur, alors que mon corps frémit de cette échappée. Pourquoi les retenir alors qu'ils révèlent leur éclat dans la chute. Des mouvements du cœur qui sont comme des appels divins, et les corps en restent silencieux alors qu'ils sont livrés à eux-mêmes sans égard pour la belle pensée qui divaguent sur les chemins balisés. Cette belle pensée est en retrait, ébahie, et sa vertu se tapit dans un coin à ne savoir que faire. Un corps à l'abandon chanté par la voix sombre d'un pope, Vladislav. Il rêve qu'il vole, qu'il survole, perclus d'antagonismes, au fond des racines de ses propres croyances. Il est le passe-muraille des églises orthodoxes qu'il croise sur sa route et dans lesquelles il se voit prêcher. Avant qu'il ne les visite, une batterie tachycarde le rappelle à la terre, et les notes du clavier effréné transforment en extrasystoles les cordes qui vibrent dans ces grottes.
Des notes aiguës comme des petites offrandes en chapelets qui me glissent entre les doigts, et je les regarde tomber, lentement, presque en apesanteur, alors que mon corps frémit de cette échappée. Pourquoi les retenir alors qu'ils révèlent leur éclat dans la chute. Des mouvements du cœur qui sont comme des appels divins, et les corps en restent silencieux alors qu'ils sont livrés à eux-mêmes sans égard pour la belle pensée qui divaguent sur les chemins balisés. Cette belle pensée est en retrait, ébahie, et sa vertu se tapit dans un coin à ne savoir que faire. Un corps à l'abandon chanté par la voix sombre d'un pope, Vladislav. Il rêve qu'il vole, qu'il survole, perclus d'antagonismes, au fond des racines de ses propres croyances. Il est le passe-muraille des églises orthodoxes qu'il croise sur sa route et dans lesquelles il se voit prêcher. Avant qu'il ne les visite, une batterie tachycarde le rappelle à la terre, et les notes du clavier effréné transforment en extrasystoles les cordes qui vibrent dans ces grottes.
À la droite de Vladislav le pope, Airin tremble. La prière d'Airin se fait sur la pointe des pieds, le corps aspiré par la foule. Et dans le ciel de Vladislav, elle avance en battant des jambes, sa nage électrique est toute féminité. Ses rêves à elle naissent dans un balancement de part en part, le regard couvert d'une pudeur cristallisée. Non loin d'eux, l'homme au clavier pose un premier pas précipité d'une course qui n'aura jamais lieu, puis le retire, en autoreverse. Il refait, frénétiquement, sans cesse son départ. Les mélodies, appels de phares au petit jour, éclairent cette vapeur matinale courant au devant des frôlements de nos corps. Un galop d'images se succèdent, et éclaboussent les cymbales, bornes d'une route sans fin. Insidieusement, un souvenir mélancolique se répand dans la mémoire.
Je peux le dire maintenant, j'ai parcouru des steppes en décapotable sous un soleil méditerranéen égaré, moi-même perdu dans le chapitrage de mon propre road-movie. Je suis passé de la lumière chaude aux perles suspendues d'un brouillard et la main sur la pomme froide du levier de vitesse, j'ai accéléré non pour fuir cet espace blanchâtre, mais pour m'y perdre bien plus. Mon dos s'est plaqué au cuir du siège de la décapotable, écrasant les perles en suspension désireuses de se nicher là, à l'abri du vent. Il y eut une propulsion de mon propre corps à l'intérieur de moi. Elle fit naître une seconde fois tout ce que je ressentis précédemment et me déposa au cœur de la nuit.
Je peux le dire maintenant, j'ai parcouru des steppes en décapotable sous un soleil méditerranéen égaré, moi-même perdu dans le chapitrage de mon propre road-movie. Je suis passé de la lumière chaude aux perles suspendues d'un brouillard et la main sur la pomme froide du levier de vitesse, j'ai accéléré non pour fuir cet espace blanchâtre, mais pour m'y perdre bien plus. Mon dos s'est plaqué au cuir du siège de la décapotable, écrasant les perles en suspension désireuses de se nicher là, à l'abri du vent. Il y eut une propulsion de mon propre corps à l'intérieur de moi. Elle fit naître une seconde fois tout ce que je ressentis précédemment et me déposa au cœur de la nuit.